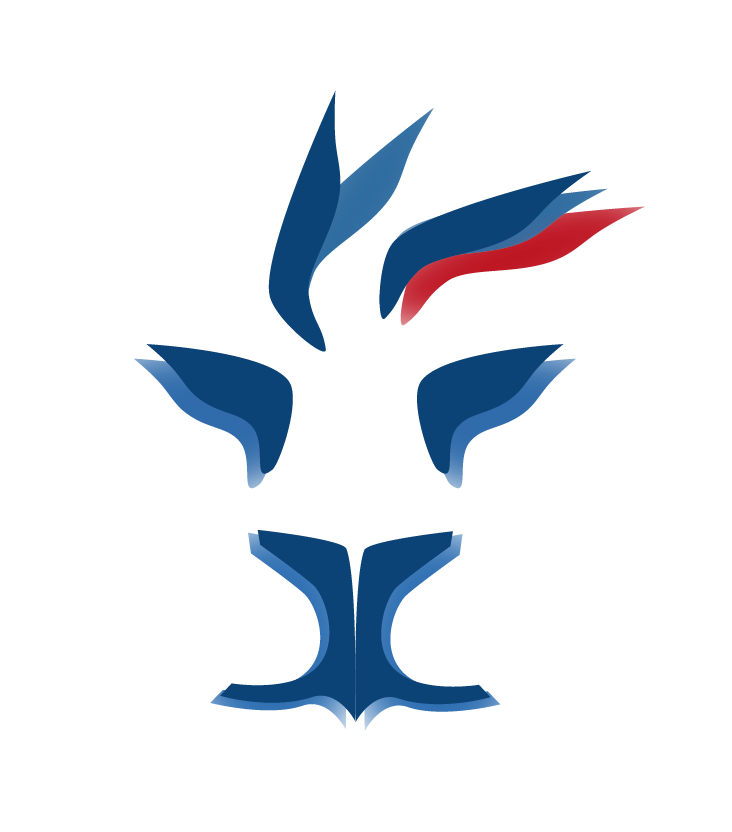Le mardi 6 juin 2023 à sept heures du matin, plusieurs rapports annoncèrent un grave endommagement du barrage hydroélectrique de Kakhovka, sous contrôle russe depuis fin février 2022 ; dans la journée, le directeur de l’opérateur ukrainien Ukrhydroenergo, Igor Syrota, reconnut à la télévision ukrainienne que le barrage était complètement détruit et en train d’être emporté par les eaux[1]. Construit par les Soviétiques en 1956 dans la région de Kherson, au sud de l’Ukraine, il constituait l’une des plus grandes infrastructures ukrainiennes de ce type. Le barrage avait déjà été détérioré en novembre 2022 par des bombardements et en mai 2023 par des débordements d’eau, attribuables à une mauvaise gestion du réservoir par l’occupant russe[2] ; dès le 2 juin, des images satellites révélaient qu’une partie de la route passant sur le barrage avait été emportée. Dans ces conditions, la centrale hydroélectrique de Kakhovka pouvait céder sous le poids de l’eau, en dehors de tout acte de sabotage.
Dès le mardi 6 juin, les deux belligérants se renvoyèrent l’attribution de l’attaque. Selon la compagnie hydroélectrique ukrainienne, Ukrhydroenergo, la destruction du barrage aurait été provoquée par une explosion qui aurait eu lieu à 2 h 50 du matin, et qui aurait été causée par des mines installées par les Russes à l’intérieur de l’infrastructure. Notons qu’en octobre 2022, l’Ukraine avait déjà réclamé une mission d’observation internationale au barrage de Kakhovka, accusant Moscou d’avoir miné l’infrastructure ; la Russie avait démenti tout minage du barrage et dénoncé les « mensonges » ukrainiens. Au contraire, selon le maire russe de la ville occupée de Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, il n’y aurait eu ni mines, ni explosions : en revanche, des frappes ukrainiennes auraient détruit les robinets-vannes du barrage et provoqué un « rejet d’eau incontrôlable » ; le barrage se serait ensuite effondré sous la pression de l’eau. Ces récits contradictoires révèlent un volet caractéristique de la guerre en Ukraine : si le déni d’attribution semblait caractéristique de la guerre irrégulière, il s’étend désormais à des opérations plus lourdes, depuis le sabotage d’un pipe-line jusqu’à la destruction délibérée d’un barrage.
Moscou et Kiev exigèrent la convocation en urgence d’une réunion du conseil de sécurité des Nations unies, qui eut lieu le mardi 6 juin à 22 h. Quels sont les intérêts en jeu, qui auraient pu justifier un « sabotage délibéré » de la part de l’une ou l’autre des deux puissances belligérantes ?
En première analyse, l’Ukraine et la Russie paraissaient toutes deux perdantes, dans la mesure où les inondations et les pénuries d’eau touchaient à la fois les zones sous contrôle ukrainien dont la ville de Kherson, sur la rive nord du Dniepr, et celles sous occupation russe, sur la rive sud. Cependant, Kiev et Moscou s’efforcèrent de montrer quel intérêt pouvait représenter, pour leur ennemi, la destruction du barrage. Premièrement, les Russes rappelèrent que le barrage alimentait en eau la péninsule criméenne, annexée dès 2014 et stratégique à la fois pour l’accès à la mer et pour la production de blé. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, déclara que Kiev avait pour objectif de priver d’eau la Crimée en rendant inopérant sinon en faisant disparaître le canal de Crimée du Nord — dont la reconquête constituait par ailleurs l’un des objectifs militaires affichés de Kiev. Les offensives russes auraient ainsi pu être entravées par la perte totale de soutien des populations des territoires annexés, désormais privées d’eau, sinon d’électricité. Comme jadis les sièges de villes fortifiées, comme les blocus qui se multiplièrent au XXème siècle, l’orchestration d’une pénurie d’eau aurait été, selon la thèse déployée par Moscou, utilisée comme arme stratégique par l’Ukraine. Deuxièmement, les Ukrainiens accusèrent la Russie, qualifiée d’« État terroriste » devant la Cour internationale de justice, d’avoir voulu entraver, par les inondations, les avancées des troupes ukrainiennes. Avec une hausse de son niveau de deux à quatre mètres, le Dniepr, ligne de front naturelle entre les forces belligérantes, devenait infranchissable y compris pendant les sécheresses estivales. Par ailleurs, le déplacement de milliers de civils suite aux inondations entravait toute action offensive, et les Russes pouvaient déployer leurs moyens militaires ailleurs.
La technique militaire de l’inondation n’est pas nouvelle : par exemple, en 1941, le barrage ukrainien de Zaporijjia avait été miné par les Soviétiques pour ralentir l’avancée allemande. Pendant la guerre d’Ukraine, cette même technique fut d’ailleurs employée par les deux ennemis. Lors de la bataille de Kiev, les Ukrainiens bloquèrent la marche des Russes vers la capitale en faisant sauter des retenues d’eau sur une des rivières affluentes du Dniepr ; à l’automne 2022, les Russes ralentirent l’avancée ukrainienne vers Kherson en détruisant partiellement, sous les bombes, le barrage de Kryvyï Rih. Pourtant, selon les déclarations de Volodymyr Zelensky, les inondations qui eurent lieu suite à la destruction du barrage de Kakhovka ne constituèrent pas une entrave majeure : les troupes ukrainiennes demeuraient prêtes à libérer les territoires occupés. De fait, d’après Jean-Claude Allard, chercheur associé à l’IRIS, les rives du Dniepr en aval du barrage et jusqu’à la mer, marécageuses, seraient impropres à un franchissement offensif, même sans inondation. De deux choses l’une : ou bien l’Ukraine, dans le cadre de la propagande de guerre, minimisait les dégâts, ou bien les Russes avaient commis une erreur stratégique, à moins que leur objectif ne fût tout autre. Si l’inondation fut bien utilisée par les Russes comme arme stratégique, c’est peut-être dans le cadre d’une « tactique de la terre brûlée », ou, en l’occurrence, de la « terre inondée » : les Russes, incapables de conserver le contrôle sur les terres occupées, les détruiraient, notamment en sabotant le potentiel énergétique ukrainien, avant de les évacuer[3]. Selon l’analyse du général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU, la Russie témoignerait, par cet acte de destruction, du fait qu’elle est désormais en « position défensive » dans le conflit en Ukraine[4].
Toutefois, à la date du 8 juin, aucune preuve matérielle décisive (explosif ou munition utilisée) ne permettait de trancher entre les deux versions des faits, celle de l’explosion, qui inculperait directement les Russes, ou celle des frappes aériennes[5] ; d’ailleurs, il se peut que des preuves soient contrefaites : par exemple, il fut prouvé que la vidéo d’explosion de barrage diffusée dès le mardi 6 juin sur les réseaux sociaux puis sur les médias datait en fait du 12 novembre 2022. Avant la réunion du conseil de sécurité des Nations unies, le mardi 6 juin à 22 h, l’ambassadeur adjoint des États-Unis reconnaissait d’ailleurs devant les médias ne pas disposer d’informations indépendantes sur les circonstances de la destruction. Dans une version comme dans l’autre, l’opinion internationale était visée : condamner l’ennemi pour sa brutalité permettait à la fois de rendre légitimes d’éventuelles opérations à venir, de solliciter des aides financières et militaires, ou de réclamer que l’autre belligérant soit sanctionné[6]. C’est dans ce cadre que Kiev et Moscou déployèrent simultanément un même discours sur le crime de guerre d’une part et sur le terrorisme écologique d’autre part.
En premier lieu, la Russie et l’Ukraine, adhérentes de la Convention de Genève[7] établie le 12 août 1949 pour fixer les règles principales de la protection des civils en temps de guerre, s’accusèrent mutuellement, dès le mardi 6 juin, d’avoir commis un crime de guerre, en violation du droit international sur les conflits armés. Alors que le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, dénonçait un crime de guerre, l’ambassadeur russe Vassily Nebenzia, accusait Kiev, soutenue par ses « parrains occidentaux », de crime de guerre. Si sabotage il y eut, la qualification de crime de guerre pourrait être justifiée. En effet, la Convention de Genève accorde un statut privilégié aux barrages hydroélectriques, comme à d’autres infrastructures contenant des « forces dangereuses » (centrales nucléaires, digues), parce que leur destruction éventuelle entraînerait des « pertes sévères » dans la population civile (Protocole additionnel à la Convention de Genève, chapitre III, article 56-1). La Convention autorise toutefois les frappes sur des barrages hydroélectriques à condition que ce soit le seul moyen de faire cesser un appui régulier, important et direct d’opérations militaires pour lequel les barrages auraient été utilisés, en lieu et place de leur « fonction normale » (la production d’électricité). Seule une enquête pourra déterminer si la destruction du barrage de Kakhovka relève d’un tel cas exceptionnel.
Cependant, les condamnations de la Russie pour crime de guerre fusèrent dès mardi ; elles émanèrent du porte-parole de la Maison Blanche John Kirby, du chef de la diplomatie britannique James Cleverly, du président du Conseil européen Charles Michel, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen[8] ; d’autres personnalités choisirent de ne pas employer directement l’expression « crime de guerre », comme la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui dénonça un acte grave et inexcusable ; quant à Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il ne mentionna pas l’acte de sabotage, préférant souligner les conséquences humaines, économiques et écologiques de la destruction du barrage.
En deuxième lieu, les deux puissances ne manquèrent pas de s’accuser mutuellement de terrorisme environnemental — il pourrait s’agir de la plus grande catastrophe écologique sur le territoire ukrainien depuis l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986[9]. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, dénonça un acte de sabotage aux conséquences humaines et écologiques très graves. Du côté ukrainien, Sergiy Kyslytsya, ambassadeur ukrainien aux Nations unies, dénonça un acte de « terrorisme écologique et technologique » ; le parquet régional de Kherson ouvrit une enquête préliminaire non seulement pour « violation des lois et coutumes de la guerre » mais aussi pour « écocide » ; mardi soir, Volodymyr Zelensky déclara que le sabotage russe était une « bombe environnementale de destruction massive », avant d’écrire de la Russie qu’elle était en « guerre contre la vie, contre la nature, contre la civilisation » — l’envoyé spécial du pape François était alors en visite à Kiev.
Quelles sont, précisément, les conséquences écologiques et humaines de la destruction du barrage, indépendamment de son caractère criminel ou non, et de l’identité de l’éventuel coupable ? Deux phénomènes graves affectèrent la zone d’occupation russe et la zone sous contrôle ukrainien, qui modifiaient les cartes de l’affrontement militaire et qui étaient susceptibles de mener à des conflits écologiques et à des migrations environnementales.
Premièrement, un vaste territoire devint, sinon inaccessible, du moins inutilisable, non seulement pour les habitations, mais aussi pour les infrastructures industrielles et civiles. D’une part, à mesure que le réservoir de Kakhovka se vidait (de 5 cm par heure, pendant 3 à 10 jours selon les estimations), les rives du Dniepr étaient inondées. D’autre part et conséquemment, les plaines furent polluées. Les flots charrièrent des mines et des engins explosifs susceptibles d’exploser sous les bombardements. Par ailleurs, 150 tonnes d’huile de moteur furent déversées dans le Dniepr, et plus de 300 tonnes pourraient encore s’y écouler. Sous le double effet des inondations et des pollutions, il fallut évacuer de nombreux territoires. Ainsi, dès mardi, l’Ukraine annonça qu’entre 16 000 et 17 000 civils, répartis dans 80 localités inondées ou en voie d’inondation, étaient évacués, 40 000 civils étant susceptibles de l’être dans des zones jugées critiques. Sur la rive sud, où les dégâts furent très importants, entre 22 000 et 40 000 civils, répartis dans 14 localités, se trouveraient dans la zone sinistrée : la Russie, qui avait d’abord déclaré que la situation, sous contrôle, n’exigeait aucune évacuation massive car les grandes localités n’étaient pas menacées, organisa aussi des évacuations, au moins dans les trois localités des zones côtières[10]. Sur les deux rives, l’inondation rendit l’évacuation difficile : par endroit, les gros véhicules ne pouvant plus circuler, le recours aux bateaux devint indispensable ; la pollution, quant à elle, risquait d’être véhiculée jusqu’à des régions d’abord jugées sûres.
Deuxièmement, les deux rives du Dniepr furent d’emblée confrontées à une double pénurie, dont la gravité pourrait s’accroître dans les jours prochains : une pénurie d’énergie, et une pénurie d’eau. Concernant l’énergie, non seulement le barrage hydroélectrique de Kakhovka cessa immédiatement d’être productif, mais la centrale thermique de Kherson fut d’emblée menacée par un risque d’inondation, comme le rappela le ministère ukrainien de l’Énergie. Concernant l’eau, la destruction du réservoir et la pollution de l’eau entraînèrent une réduction drastique de l’accès à l’eau potable ; des villes comme Kryvyï Rih décidèrent de rationner la consommation d’eau. L’Ukraine alloua un budget de 60 millions de dollars à l’accès à l’eau potable (construction de nouvelles conduites, distribution d’eau potable). La pénurie d’électricité et d’eau, dramatique pour les conditions de vie, l’est aussi pour la production, et en particulier pour la production agricole : le réservoir de Kakhovka fournissait en eau les agriculteurs tout le delta du Dniepr, l’une des régions agricoles les plus fertiles de l’Ukraine : désormais, le risque d’assèchement menace la production agricole[11]. De surcroît, la baisse du niveau d’eau en amont du barrage entraîna une mortalité massive des poissons, mollusques et autres espèces aquatiques, et donc une diminution des ressources halieutiques. Enfin, soulignons que la pénurie d’eau pourrait engendrer une catastrophe nucléaire dans la centrale de Zaporijia[12], située 150 km2 en amont du barrage de Kakhovka. Tout danger nucléaire immédiat fut d’emblée écarté par Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)[13] : certes, le réservoir de Kakhovka contribuait directement au refroidissement des réacteurs, mais la centrale est directement connectée à un grand bassin de rétention dont le niveau d’eau est stabilisé autour de 16 m. Cependant, le refroidissement de la centrale deviendrait impossible si le niveau chutait en-deçà de 12,7 m — Rafael Grossi indiquait qu’il n’y aurait alors que quelques jours pour trouver une solution — ; selon ses termes, il est désormais « vital » que le bassin soit protégé.
Mis à jour le 06/06/2023 à 15:14