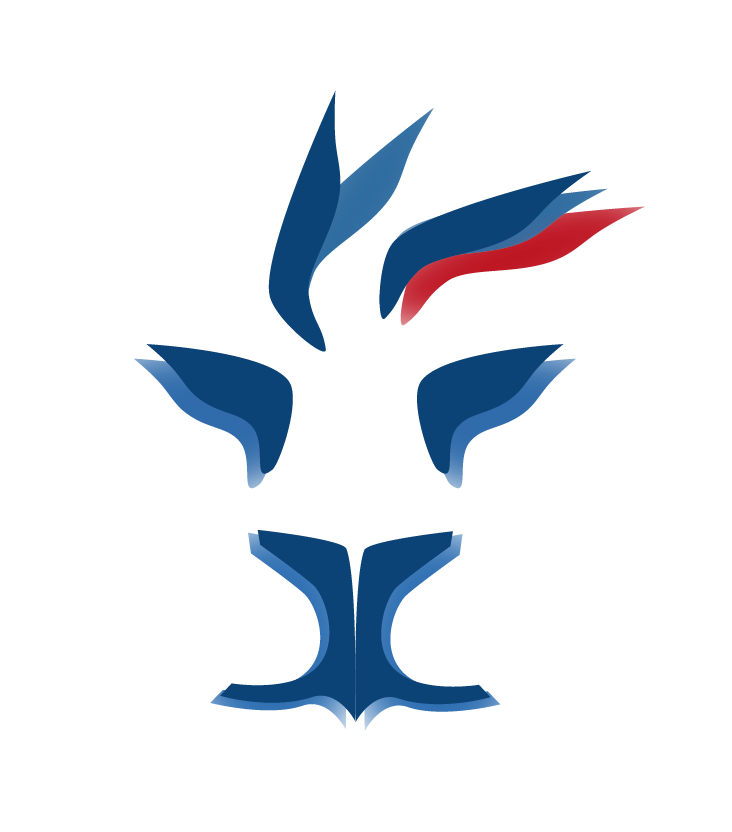« Un prince qui peut tout ne doit pas tout vouloir. »
Robert Garnier, Les Juives, Acte III, 1583
Par Simon Roche,
Israël s’apprête à lancer son offensive sur Rafah, dernière grande ville méridionale de la bande de Gaza. Pour la population palestinienne il n’y a rien après Rafah : le poste frontière est fermé par l’Egypte depuis novembre dernier. C’est dans cette ultime grande ville que les déplacés gazaouis se rassemblent alors que sur leurs arrières s’amoncellent les destructions de la guerre. Après plus de cent jours de conflits, ce sont 28 000 Gazaouis qui ont trouvé la mort pour quasiment 70 000 blessés[1]. Majoritairement des civils car seulement 9 000 combattants du Hamas sont compris dans ces pertes – sur les 20 à 30 000 qui étaient présents dans les rangs avant l’offensive du 7 octobre 2023[2]. A ces pertes effarantes s’ajoute la précarité de la vie à Gaza, dont les témoignages sont massivement retranscrits dans les médias occidentaux. Le dernier drame en date, le siège de l’hôpital Nasser de la ville de Khan Younès dans lequel était retranché les soignants, les patients et 10 000 déplacés au milieu desquels, selon Tsahal, se seraient cachés des combattants du Hamas[3]
Ces destructions sont la transcription physique des objectifs militaires, dont la radicalisation ne semble à ce jour subir ni nuance ni contrainte : l’Etat d’Israël, menacé dans sa survie même par un groupe dont l’objectif est « de libérer la Palestine et d’affronter le projet sioniste »[4], mène alors une « guerre contre le terrorisme » en plein territoire étranger. Une guerre qui s’inscrit alors dans la continuité d’un discours développé dès les années 1980 par l’actuel Premier Ministre, Benjamin Netanyahou, alors jeune diplomate à Washington puis à l’ONU, qui popularise déjà le concept de « guerre contre le terrorisme » au sein de la communauté stratégique occidentale[5]. Le choix de la guerre contre le terrorisme, qui se retranscrit dans le jusqu’auboutisme des opérations militaires, entre pourtant en contradiction avec le second objectif de la guerre, celui de libérer les otages.
Les voix dissonantes sont nombreuses et surtout présentes dans l’espace public. Les manifestants demandant des négociations ou une trêve avec le Hamas se rassemblent tous les soirs sur ce qu’ils ont rebaptisé la « place des otages » à Tel-Aviv. Pourtant Benjamin Netanyahou rejette fermement cette possibilité : à la veille de lancer l’offensive sur Rafah, il rappelle que l’objectif est la « victoire absolue » et que ne pas aller au bout de celle-ci revient à « perdre la guerre »[6]. Pourtant, en faisant le choix de suivre une ligne militaire dure Benjamin Netanyahou mène inévitablement le conflit vers les extrêmes.
La stratégie d’Israël se conforme alors au but politique circonscrit, celui d’éliminer l’organisation terroriste du Hamas. Mais pour le malheur des stratèges israéliens et du peuple palestinien, la force de la guerre irrégulière et asymétrique menée par les groupes terroristes réside dans la capacité à fondre la silhouette militante et militaire des combattants dans la masse et la vie de la population. Israël tombe alors dans le dilemme au cœur de la pensée occidentale du terrorisme, celui de combattre « l’anti-soldat » en devant lui déclarer la guerre[7], quand bien même cela doit avoir lieu en plein cœur de la société civile.
Pourtant la sagesse militaire appelle, après tant de destruction et des résultats mitigés, à une trêve et à une négociation, le politique reprenant les rênes d’une guerre en imposant « la suspension de l’acte de guerre »[8]. Cette demande est désormais portée par une part conséquente du cabinet militaire, dont certains des membres pourtant les plus radicaux commencent à critiquer publiquement la conduite de la guerre de leur Premier Ministre[9]. Ces voix témoignent de la conscience que la « victoire absolue »[10] n’est pas une fin en soi de la guerre, comme l’évoquait déjà le philosophe français Raymond Aron : « la victoire militaire n’est pas la fin ultime, elle n’est, elle aussi, qu’un moyen en vue de la véritable fin ultime, la paix, dans laquelle les volontés adverses s’unissent »[11].
La guerre israélienne offre ainsi le cas d’une stratégie conforme au niveau inférieur sans l’être au niveau supérieur ; les moyens de la guerre y sont en adéquation avec les buts dans la guerre mais ne le sont pas avec les buts de la guerre, ces derniers restant invariablement le retour à la paix. Or quelle paix concevoir avec un Etat dont la population est aujourd’hui humiliée, alors que réapparait dans les discours arabes le terme de Nakba (de l’arabe « catastrophe ») forgé en 1948 pour qualifier le déplacement forcé de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens suite à la défaite arabe dans la guerre de 1948-1949[12] ? Un traumatisme originel, qui est au fondement de la construction des discours politiques palestiniens, et est à la base du ressentiment du monde arabe à l’égard de l’Etat d’Israël. Cette situation qui perdure entache durablement la résolution du différend israélo-palestinien, qui n’est pas l’affaire d’un Etat face à une organisation terroriste mais bien d’un Etat à l’égard d’une population nationale aujourd’hui déplacée, exilée et appauvrie. Une situation ancrée dans l’histoire car elle provient de l’échec du plan de partage de 1947 qui devait permettre une solution à deux Etats mais dont l’application achoppa du fait du déclenchement de la guerre israélo-arabe. Trente ans plus Raymond Aron décrivait déjà le ressentiment de ces Palestiniens qui avaient alors perdu leur foyer : « Un million environ de Palestiniens ont fui des villages et des villes qui sont aujourd’hui habités par des Israéliens. Dispersés entre le Liban, la Cisjordanie, la Jordanie, la Syrie, la zone de Gaza, les uns dans des camps, les autres plus ou moins intégré à un pays d’accueil, ils restent en grand nombre déracinés et irréconciliables »[13]. Une situation que ne parvint pas à résoudre les accords d’Oslo I (1994) et d’Oslo II (1995), qui devaient permettre la reconnaissance de l’Autorité Palestinienne et une évacuation militaire des territoires occupés. Ces accords, instaurant une période de transition de cinq années, n’aboutirent pas, les deux parties étant gagnées par leurs extrêmes : le Hamas s’octroyait une légitimité politique en se lançant dans une série d’attentat contre les civils israéliens alors que le parti Likoud, emmené par Benjamin Nétanyahou, revenait au pouvoir.
Les conséquences de la guerre seraient de grande ampleur pour Israël et contreproductives pour sa sécurité : en nourrissant la haine des autres pays arabes – alors que la crainte de l’extension du conflit est bien réelle – et des populations gazaouies, elle nourrirait pendant des décennies une insécurité qui n’aurait pas disparu avec le Hamas. Bien pire, le caractère parfois inhumain de la contre-offensive israélienne entache déjà l’image de l’Etat hébreu sur la scène internationale : sans remettre en question son réseau d’alliance et de clientèle, les partenaires européens[14] et l’allié américain[15] se montrent de plus en plus mal à l’aise à l’égard du déroulement de la guerre. Ainsi, que ce soit à ses frontières ou au sein du système international, les conséquences politiques de la « victoire absolue » seront inverses aux buts de la guerre qui sont de forger une situation pacifique sécuritaire optimale pour l’Etat israélien. Cette exigence qui incombe au chef de l’Etat de penser à la paix dès les plans de guerre est ce que l’historien britannique Liddell Hart a nommé dans son ouvrage de 1954 la « grande stratégie » : « si l’horizon de la stratégie est borné par la guerre, la grande stratégie regarde au-delà de la guerre, vers la paix qui doit lui succéder. Elle ne doit pas se contenter de combiner les divers instruments de guerre, mais en réglementer l’emploi afin d’éviter ce qui pourrait porter préjudice à la future paix qui doit être solide et prospère »[16].
[1] Selon les chiffres donnés à la mi-février par le ministère de la Santé du Hamas.
[2] Les estimations oscillent entre 20 000 (SMALLER, Andrès, « Le Hamas dispose encore de sept combattants sur dix », Le Temps, ) et 30 000 combattants (REMY, Jean-Philippe, « Cent jours de guerre à Gaza : un bilan effroyable et pas de perspective de sortie de crise », Le Monde, édition du 15 janvier 2024.
[3] MRAFFKO, Clothilde, « L’armée israélienne attaque l’hôpital Nasser de Khan Younès, le plus grand encore en service à Gaza », Le Monde (site web), 16 février 2024.
[4] Article 1er de Principes et Politiques Généraux du Hamas d’octobre 2017.
[5] FILIU, Jean-Pierre Main Basse sur Israël. Nétanyahou et la fin du rêve sioniste, La Découverte, 2019.
[6] BRUNEL, Pascal, « Guerre à Gaza : Netanyahou prêt à attaquer à Rafa », Les Echos, édition du 18 février 2024
[7] HOLEINDRE, Jean-Vincent, La Ruse et la force. Une autre histoire de la stratégie, Paris, Perrin, 2017.
[8] Titre du chapitre XVI du Livre III (« De la stratégie en général ») du De la Guerre de Clausewitz.
[9] IMBERT, Louis, « En Israël, les divisions du cabinet de guerre s’expriment en public », Le Monde, édition du 22 janvier 2022.
[10] Expression employée par Benjamin Netanyahou, interrogé sur la possibilité de suspendre les opérations sur Rafah.
[11] ARON, Raymond, Penser la guerre, Clausewitz. 2. L’âge planétaire, Paris, Gallimard, 1976, p. 257.
[12] Un évènement pour la première fois comméré par l’ONU en mai 2023, soit quelques mois avant l’attaque du Hamas et la contre-offensive d’Israël.
[13] Ibid., p. 197.
[14] Joseph Borell, chef de la diplomatie de l’Union européenne, a ainsi dénoncé, dans une interview donnée aux médias le 22 janvier 2024, le fait que les Israéliens étaient en train de « semer les graines de la haine pour des générations à venir »
[15] BRUNEL, Pascal, « Joe Biden sanctionne des colons israéliens violents », Les Echos, édition du 2 février 2024.
[16] LIDDELL HART, Sir Basil, Stratégie, 1954, trad. de Lucien Poirier, Paris, Perrin, 1998, p.518.