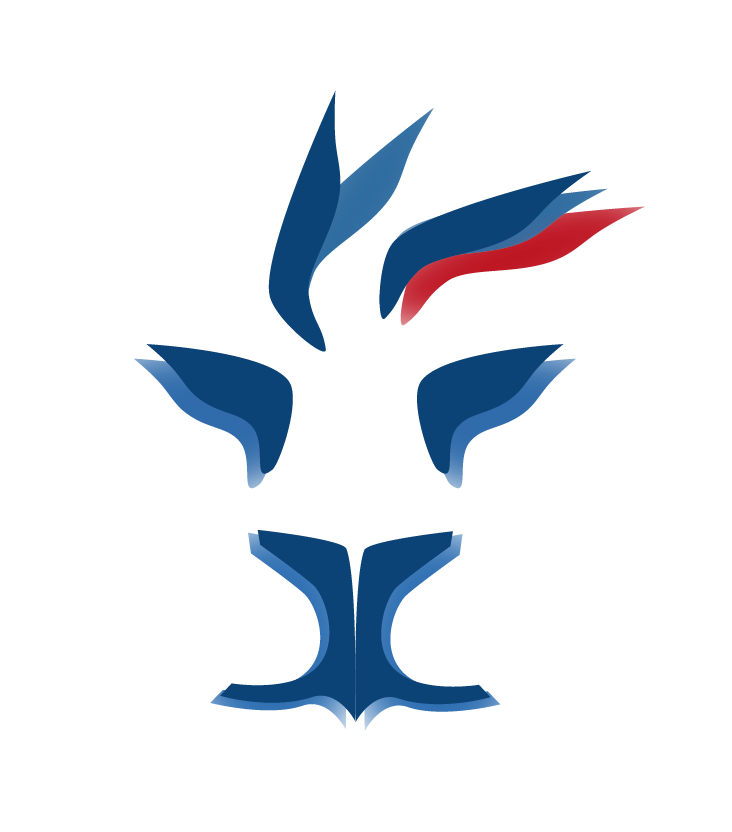Paris, Armand Collin, 1963.
Depuis le 5 octobre dernier, la capacité nucléaire américaine est de nouveau publique. Renouant avec une tradition historique de transparence, le président Joe Biden et son administration ont voulu marquer une rupture avec Donald Trump. Si l’information était jusqu’alors secrète, il est désormais public que les Etats-Unis détiennent 3750 têtes nucléaires, ce chiffre comprenant les têtes dites « actives » – en mesure d’être déployées – ainsi que les têtes retirées, dites « obsolètes ». A ce chiffre, il faut rajouter les têtes en cours de démantèlement, ce qui porterait leur nombre à 5550 pour l’année 2021[1].
Si un tel chiffre a quelque chose de glaçant[2], la décision de publication renoue avec la logique de la transparence qui avait émergé dans les années 1960 entre les deux grandes puissances nucléaires de l’époque (Etats-Unis et URSS). Atteignant son apogée durant cette décennie – les arsenaux comprenaient alors entre 25 000 à 30 000 têtes nucléaires –, la raison politique avait amené les deux Etats à une meilleure maitrise des armements. D’un paradigme de la dissuasion, la stratégie nucléaire était passée à un paradigme de la maitrise des armements, première pierre de notre actuelle lutte contre la prolifération. Or, il ne s’agissait pas de renier la capacité nucléaire des Etats, mais bien plutôt d’engager une première forme de dialogue, afin d’assurer la dissuasion en la stabilisant. Comme l’écrivait Raymond Aron, témoin des évolutions stratégique de l’époque : « la maitrise des armements n’implique pas le désarmement, […] elle implique une coopération implicite ou explicite entre ennemis, ayant pour but l’établissement d’un rapport de forces qui dissuade les duellistes de recourir à la guerre[3] ». Dans cette logique, la guerre nucléaire ne disparaissait pas, elle devenait juste un peu plus déraisonnable à mesure que les Etats-Unis et l’URSS entraient dans la voie du dialogue.
Connaitre la capacité de destruction de l’ennemi en face, tout en gardant la main sur le téléphone rouge : cette nécessité de dialoguer débouchait en 1974 sur l’accord de Vladivostok, accord-cadre destiné à établir une « équivalence » entre les forces nucléaires des deux Etats. Malgré les difficultés de la définition de cette équivalence, exacerbée par les rivalités, la coopération aboutit en 1979 à l’accord Salt II (Strategic Arms Limitation Talks), première étape d’une limitation de l’ensemble des arsenaux nucléaires et qui préfigure la réduction du nombre de têtes – qui débute quant à elle en 1991 avec l’accord Start I.
Or tel l’enfant prodigue, les Etats-Unis reviennent aujourd’hui à une tradition de maitrise des armements pour mieux capitaliser sur leurs atouts stratégiques. Alors qu’ils annoncent publiquement leur nombre de têtes nucléaires, les Etats-Unis marquent le coup dans la prolifération des technologies militaires nucléaires. De fait, avec l’accord AUKUS (Australia, United Kingdom, and United States) et l’annonce de la cession de sous-marins à propulsion nucléaire, les Etats-Unis deviennent le premier Etat nucléarisé à vendre une technologie nucléaire à usage militaire à un Etat qui ne l’est pas. L’affaire est d’autant plus inédite que l’Australie est connue de longue date pour son rejet du nucléaire, après que son territoire ait subi les essais britanniques au XXe siècle dans la zone reculée et désertique de Maralinga. L’idée de se doter de sous-marins nucléaires d’attaque semble par ailleurs disproportionnée avec les besoins australiens. Une telle technologie navale est utile pour patrouiller loin de ses bases, dans des eaux extraterritoriales contestées. Mais cela répond-il vraiment à un besoin objectif et réfléchi de l’Australie ou des Etats-Unis ? Contre toute logique stratégique, les moyens ne semblent plus s’accorder à la fin.
Le gain tactique, d’une technologie navale disproportionnée eu égard des besoins de l’Australie, pourrait cependant produire une fragilisation des Etats-Unis sur le plan international et stratégique : en ouvrant la brèche, qu’en sera-t-il de ce précédent lorsque la Russie ou la Chine, les grands rivaux du XXIème siècle, décideront de léguer cette technologie à des Etats vassaux ? Cette interrogation prend toute son ampleur alors que le ton monte entre Téhéran et Washington sur le nucléaire ces derniers jours. Anthony Blinken, secrétaire d’Etat américain a laissé planer la menace militaire sur l’Iran si le gouvernement islamique n’acceptait pas de reprendre le dialogue sur le dossier nucléaire. Menace proférée publiquement, le 13 octobre dernier, alors que le secrétaire d’Etat recevait son homologue israélien. De l’autre côté, Téhéran se tourne désormais vers la Chine et la Russie, par l’adhésion à l’organisation de coopération de Shanghai, avec la promesse d’une coopération économique à la clé. Pour Téhéran, la possibilité d’accéder à de nouveaux interlocuteurs pour le nucléaire civil ; pour Washington, la perte de tout contrôle sur le développement d’un potentiel programme nucléaire militaire iranien.
Ces incertitudes invitent à replacer la technologie nucléaire dans son champ d’action privilégié, qui n’est jamais réellement la tactique où elle se sent à l’étroit, mais bien la stratégie, fille de la diplomatie et des relations internationales. Et en cette matière, l’administration Biden fait preuve de naïveté en pensant qu’un sous-marin à propulsion nucléaire se vend comme un F-35. Le nucléaire appelle à la coopération, au dialogue et aux garde-fous. Et Raymond Aron encore prévenait déjà de la menace qui pesait sur le monde si la prolifération n’était pas maitrisée : « A ce moment-là, il ne subsisterait plus de différence entre le plus et le moins, entre le crime et le châtiment, entre le Grand et le Petit. Chaque Etat disposerait d’un droit de veto sur l’existence de l’autre. […] A mesure que l’humanité se rapprocherait de ce système, elle prendrait conscience qu’il lui faut renoncer au jeu diplomatico-stratégique ou à la vie »[4].