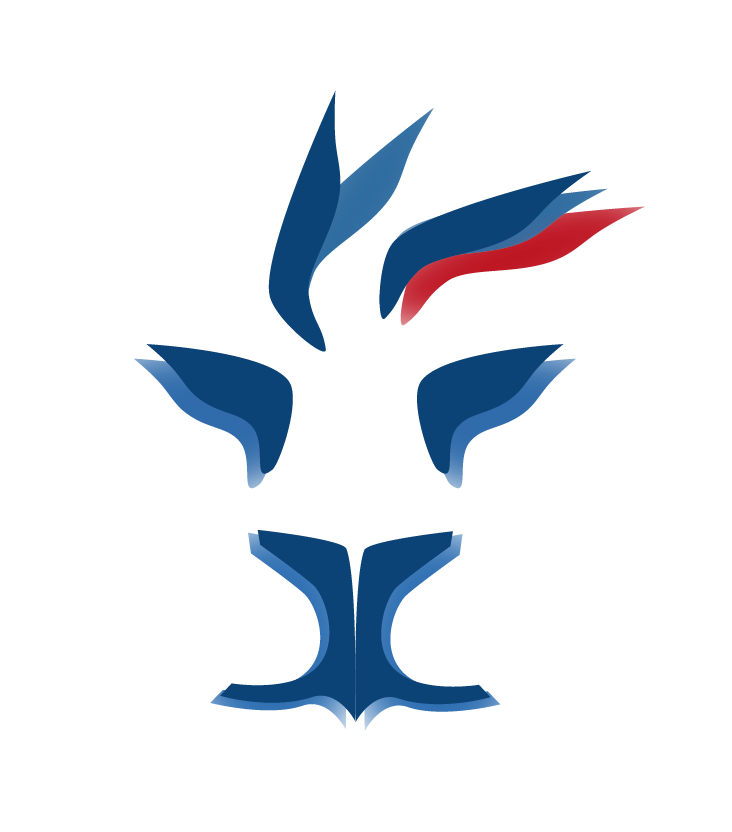Le Général Denis Mercier a été Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air entre 2012 et 2015, avant de devenir Commandant Allié transformation de l’OTAN.
Propos recueillis par Margaux Martin-Péridier
Margaux Martin-Péridier : Général, vous avez été chef d’état-major de l’armée de l’Air, puis commandant allié Transformation (ACT) de l’Otan et travaillez actuellement dans le secteur privé. Pourriez-vous nous donner des précisions sur votre travail à l’Otan ? En quoi consistait-il ?
Denis Mercier : Aujourd’hui, dans l’Otan, la structure politique est dirigée par le Conseil de l’Atlantique Nord; en dessous, et c’est la seule organisation internationale à en avoir une établie, il existe une structure militaire. Le comité militaire travaille sur le côté politico-militaire à Bruxelles. Deux commandements militaires stratégiques chapeautent la structure : le SACEUR[1] qui s’occupe des opérations, et le SACT[2], qui est le poste que j’ai occupé pendant trois ans et qui est chargé de la transformation. Mais que représentent les opérations et la transformation ? Lorsque j’ai pris mes fonctions, de nombreuses choses avaient évolué mais les périmètres n’étaient pas clairement définis. A titre d’exemple, le SACEUR est normalement en charge des opérations, du cyber, des plans de campagne… Ce n’était pas le cas : il avait une dimension capacitaire, alors que nous nous occupions de la conduite des exercices. Avec SACEUR, mon homologue américain, nous avons eu l’opportunité de mener une réorganisation, de clarifier le tout. Le commandement de la transformation est ainsi composé de trois grands piliers, qui avaient des périmètres différents lors de mon arrivée.
Le premier volet est celui de la vision d’avenir, qui part d’un document qui s’appelle Strategic Foresight Analysis (SFA). Celui-ci permet de nous aider à visualiser les tendances dans les 25 ou 30 ans à venir et les traduit en conséquences militaires. Dans cette partie-là, nous nous intéressons également aux tendances en matière de technologie, aux menaces qu’elles pourront constituer, à la manière dont on peut les utiliser comme des opportunités, aux problèmes qu’elles posent… Nous regardons aussi les partenariats avec un grand nombre de pays et nous traduisons les directives politiques en objectifs de partenariat. Dans ce premier volet, nous regardons véritablement l’avenir sous tous ses angles.
Le deuxième volet est un volet plus capacitaire : dans la réorganisation, le commandant allié pour la transformation a repris l’ensemble du développement des capacités financées en commun par l’Otan. L’Otan est composé de nations. Chaque nation paye ses propres capacités ; ce qui est financé en commun, ce sont surtout les structures de commandement c’est-à-dire le noyau sur lequel les nations viennent se poser pour mener leurs opérations. Nous y avons également ajouté l’analyse d’alternatives, qui consiste à arrêter de raisonner en solutions toutes faites et à examiner les alternatives possibles, à s’intéresser aux standards d’interopérabilité, ce qui est essentiel pour l’Otan.
Le troisième volet représente la partie haute des exercices, la réflexion sur les scénarios, l’animation des centres d’excellence, la doctrine, comment mieux modéliser ce que nous ferons. Ce sont beaucoup de choses qui tournent autour du développement de la guerre.
Ces trois volets sont donc les trois piliers de l’Allied Command Transformation (ACT) avec une large part, maintenant, dédiée à l’innovation. Une partie de l’ACT s’intéresse de surcroît aux moyens dont les nations doivent se doter pour répondre au niveau d’ambition de l’Otan, qui reposent en grande partie sur l’innovation.
Les perspectives d’innovation en France : quel rythme, quels enjeux ?
MMP : Il existe aujourd’hui de nouveaux cadres d’innovation en France : l’Agence de l’innovation de défense (avec en son sein l’Innovation Defense Lab, mis en place dès la rentrée 2018) ou encore le fond d’investissement DefInvest qui soutient des PME de la défense, notamment à l’export. Selon vous, ces nouvelles structures d’innovation sont-elles pertinentes ?
DM : Oui, je pense qu’elles sont pertinentes, mais une structure ne fait pas l’innovation. Il y a une vraie question que l’on doit retrouver : l’innovation, pour quoi faire ? L’innovation ne doit pas être l’objectif en soi. Il faut déterminer les objectifs, c’est ce que nous devons retrouver clairement dans l’actualisation qui a été faite de la Revue Stratégique de Défense Nationale. La Revue Stratégique de Défense Nationale de 2017 est de mon point de vue trop tournée vers des suggestions « classiques » : les armées y ont mis tout ce qu’elles voulaient y voir dans le court terme. Elle est surtout assez large et traditionnelle. Le véritable problème que nous rencontrons est qu’il existe de nombreuses structures, mais la clef de l’innovation se trouve dans la création d’un écosystème d’innovation.
Un écosystème centré sur l’innovation repose sur trois piliers. Tout d’abord des structures. Chaque armée a des centres de recherche, on a la Direction générale de l’armement (DGA), on vient de créer un DéfenseLab : on vient de créer tout ce qu’il faut. L’écosystème repose également sur un deuxième pilier, celui de l’expertise humaine ; nous avons déjà ces expertises, les chercheurs, les ingénieurs, les militaires. L’écosystème repose enfin sur le pilier relationnel. Ce dernier ne représente pas simplement une rencontre entre les personnes investies avec les structures : il faut une vision partagée de l’avenir que l’on veut donner à l’innovation. Tant qu’il n’y aura pas ce pilier relationnel, il n’y aura pas d’écosystème et pas d’innovation. C’est en cela qu’il faut une revue stratégique qui pose clairement cette question des objectifs à atteindre.
Sur LinkedIn notamment, on retrouve des avis qui divergent autour d’une question qui me paraît essentielle et structurante. Ceux soutiennent, parce que l’on n’a pas de budgets extensibles, que l’on doit d’abord formuler une vision pour 2030 avant de penser au long terme; c’est une vision plutôt pragmatique et de court terme. D’autres considèrent que nous savons déjà ce que nous voulons faire en 2030. Moi qui viens de l’Otan, je peux vous dire exactement en 2030 quel sera le périmètre des armées occidentales. D’ailleurs, l’horizon 2030 montre que le périmètre n’est pas idiot, dans l’hypothèse où nous serions confrontés à une crise majeure, à des ennemis étatiques ou non étatiques. Donc à partir de ce moment, la deuxième option est de se dire « investissons intelligemment, quitte à faire certaines impasses dans le court terme et portons un effort supplémentaire sur l’avenir et les innovations, celles qui changeront la façon de conduire les opérations et placeront la France en position de leader européen ». Là, on a vraiment deux positions qu’il faut trancher, ce que ne fait pas la revue stratégique.
Si on ne fait pas ce choix, on se laissera tirer par des idées mais l’innovation c’est la mise en œuvre des idées, pas les idées elles-mêmes. Dans le premier cas on limitera l’ambition à l’amélioration de l’existant. L’autre solution est d’investir sur des choses que l’on ne connaît pas, et qui pourraient faire regagner à la France sa position de leadership et de souveraineté à l’avenir. Mais le choix entre ces deux options est une affaire politique, et ce que je regrette vraiment c’est qu’elles ne soient pas posées sur la table. Donc nous n’avons pas cette vision globale d’une ambition partagée : ceux qui veulent aller au-delà des plans existants et réfléchir différemment sont souvent mis de côté dans les armées.
Par exemple, on pose aujourd’hui la question d’un second porte-avions sans avoir vraiment regardé les conséquences de la menace des armes hypersoniques. Nous sommes en retard dans le domaine du laser, nous n’avons pas investi dans le domaine de l’espace. D’autres pays sont bien plus en avance dans ces domaines. En consolidant trop nos armées sur les menaces d’aujourd’hui, on met « demain » de côté. Nous avons de nombreuses structures d’innovation mais nous n’avons pas construit les synergies nécessaires à la construction de l’écosystème dont nous avons parlé. J’entends aujourd’hui que nous suivons en quelque sorte le modèle de la DARPA[3] mais non, la DARPA c’est une organisation qui accepte de prendre les risques nécessaires pour identifier les technologies qui seront vraiment disruptives. L’objectif serait d’embarquer les armées et la DGA pour qu’elles établissent ensemble une vision d’avenir, et créer cet écosystème d’innovation en associant aussi l’industrie bien sûr. Mais tant que nous ne nous posons pas la vraie question nous n’y arriverons pas. Nous avons par exemple publié une Revue stratégique et six mois après, le président Trump a annoncé qu’il allait créer une armée de l’espace et là, la France se dit « oups », nous n’avons pas vraiment abordé le sujet dans la revue stratégique. Mais il y en a plein d’autres de domaines : la transparence des mers, les systèmes autonomes, le champ de l’information, etc.
In fine, c’est une question stratégique : doit-on consolider aujourd’hui ce que l’on a ou faut-il investir sur le plus long terme – quitte à ce que ça ne soit pas facile pendant une dizaine d’années, quitte à faire des choix? Il faut donc savoir où nous allons pour savoir dans quelles priorités nous devons investir.
MMP : La création de l’Agence d’innovation de défense va-t-elle selon vous dans le “bon sens” ? Répond-elle aux enjeux actuels de transformation de nos forces armées ?
DM : C’est une bonne chose de l’avoir créée, car cela nous manquait. Il faut qu’elle trouve sa voie. Ce n’est pas une DARPA à la française : elle ne va pas chercher des technologies de rupture. Mais en agissant avec le réseau de tous les centres d’innovation des armées (air, mer, terre) elle peut permettre d’innover réellement. Mais il faut la mettre en réseau, mettre de l’argent sur la table et se lancer dans du prototypage rapide avec cette certitude que l’innovation n’est pas l’idée mais la mise en œuvre de l’idée. Cela va être intéressant. L’Agence d’innovation de défense sera efficace à condition d’être capable d’agir en réseau, de se coordonner avec ce que font les autres agences des organisations internationales. L’autre condition est d’adopter une structure agile. Il faut séparer la gouvernance des projets : une gouvernance doit fixer le cap et les projets doivent être développés avec les armées avec un niveau d’autonomie important tant qu’ils restent dans le cadre fixé par la gouvernance. Des risques doivent être pris, des prototypes testés par les armées en acceptant de faire fausse route. Nous nous mettons parfois trop de freins en pensant à la propriété intellectuelle, aux marchés publics. Il faut avancer et apprendre en marchant quitte à se tromper. L’agence prendra alors du sens dans la coordination de la mise en œuvre de ces projets.
C’est l’objectif que l’Agence d’Innovation de Défense s’est fixée mais nous ne voyons pas encore les résultats. Finalement, l’interarmées ne fonctionne pas si bien, notamment à Paris. Les freins internes sont très forts, émanant d’une technostructure opposée à cette prise de risque. L’agence dispose d’un budget d’1,2 milliard d’euros, alors que le fonds de recherche et développement disposait auparavant de 750 millions. Mais en fait de R&D il était surtout consacré à du pré-développement au profit de grands programmes de défense parfois en compensation des baisses de budget. J’espère que ce budget porté à 1,2 milliard d’euros sera consacré à de réels projets d’innovation. La résistance continuera d’être forte car la prise de risque n’est pas dans notre culture. Il faut que le directeur de l’AID tienne tête et dise « on y va et on fait ça » en faisant travailler ensemble les grands groupes, les startups, les écoles ou universités, centres de recherche, etc, sur un pied d’égalité. Et on peut alors rêver car nous avons les talents pour trouver de véritables solutions innovantes à nos problèmes opérationnels.
MMP : On compare régulièrement la force d’innovation des armées françaises à celle des armées américaines pour souligner notre “retard” ou encore notre manque de moyens. A l’inverse, la France a-t-elle selon vous de réels atouts en matière d’innovation qui la distinguent de ses alliés ? Si oui, lesquels ?
DM : Nous ne pouvons pas dire que nous sommes « à côté de la plaque », c’est simplement que nous sommes mettons plus de freins car nous ne savons pas assez prendre de risques.
Notre première force est que nous sommes l’un des rares pays, à part les Américains, à avoir conservé l’ensemble du spectre des capacités opérationnelles : cela nous donne une expertise opérationnelle forte et unique en Europe. Nous avons développé des structures, notamment militaires, capables de tester et d’expérimenter ; de nombreux pays n’ont pas cette force. Nous avons aussi tout de même des budgets qui restent significatifs. Nous avons des gens compétents, prêts à se mobiliser à 200%. Je me souviens dans l’armée de l’Air que nous avions des sergents qui faisaient de la programmation à haut niveau à Mont-de-Marsan, c’était impressionnant. Il faut donc que l’on assimile ces structures et cette connaissance capacitaire ; parce que l’innovation de défense doit être tirée par les opérationnels, qui doivent parler avec les industries. Nous avons une très bonne base.
En termes plus techniques, nous avons abandonné un certain nombre de pans sans véritable réflexion stratégique, telle qu’une partie de notre souveraineté en matière de composants, et nous tentons aujourd’hui de retourner en arrière. Je n’ai jamais vu une étude dans la défense se pencher sur les composants stratégiques nécessaires pour ne pas déprendre des autres. Nous avons tendance à reproduire des solutions d’avant : nous avons laissé tomber l’espace, nous n’avons malheureusement pas investi dans les lasers ; nous n’avons pas suffisamment investi dans tout ce qui est vraiment très stratégique avec une vision d’avenir. C’est dommage.
Nous avons par exemple une vraie compétence dans certains domaines, comme celui des statoréacteurs : ne faisons pas la bêtise de ne pas s’appuyer là-dessus pour aller vers l’hyper vélocité qui ouvre à de véritables ruptures technologiques mais aussi opérationnelles. Il est nécessaire de développer les compétences plus lourdes, dans le domaine du numérique notamment : l’Estonie et le Portugal développent leurs capacités de cyberdéfense, le Luxembourg fait progresser ses outils de communication satellitaire … nous ne parviendrons pas à faire la différence dans tous ces domaines. Mais, nous sommes capables d’avancées en matière de capacités industrielles, car peu de pays européens en ont, hormis l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou l’Italie. Nous devons inscrire notre leadership, et pourquoi pas dans un cadre européen.
MMP : Selon vous, comment serait-il possible de rendre les programmes d’armement français plus réactifs à l’innovation ?
DM : En réalité, nous avons déjà une structure qui marche plutôt bien sur les programmes d’armement, mais nous devons absolument sortir de la dynamique « un problème amène une solution ». Le sujet n’est pas tant de disposer d’un second porte-avions que de savoir qu’est-ce qu’on veut en faire, dans quel contexte, quelles sont les menaces de demain, et comment cette capacité s’interfacera avec les autres ? Le SCAF[4] ce n’est pas la question d’une 6e génération d’avions de combat mais la vision que nous apportons avec. La technologie nous amène une vision totalement différente, de mise en réseau de toutes nos capacités avec un ou plusieurs réseaux qui relient des objets connectés. C’est ce qu’a fait l’Otan avec le standard d’interopérabilité que nous développons (FMN : Federated Mission Networking). Il faut que la France sorte et s’ouvre, qu’elle envoie des gens à l’étranger pour qu’ils comprennent le fonctionnement des structures internationales et les enjeux et qu’ils reviennent pour alimenter les structures nationales. Il faut avoir une vision multinationale avec les Français à l’étranger : il faut qu’ils reviennent et qu’ils transmettent leur expérience. On le voit dans le développement de nos capacités, trop centrés sur nous-même. Lorsqu’on parle du programme SCORPION[5], il faut déjà réfléchir aussi avec les autres armées. Il ne faut pas partir de SCORPION pour aller ensuite vers l’Otan ; il faut le penser dans l’Otan, assumer un rôle de leadership et imposer nos normes. Cependant, pour le comprendre il faut avoir envoyé des gens au préalable dans ces structures. Nous n’avons pas de leaders avec une réelle vision internationale, nous sommes « à l’ancienne » avec des leaders régionaux trop centrés sur les seules zones dans lesquelles nous sommes engagés.
Je suis parti jeune colonel à l’Otan et je me suis battu pour revenir : je ne voulais pas faire une carrière à l’international même si c’est confortable. Je voulais revenir pour transmettre l’expérience acquise. Lorsque j’étais à Norfolk, les feuilles de notation reçues de l’état-major des armées portaient « relations internationales » comme seules compétences pour les Français affectés alors que les domaines dans lesquels ils travaillaient étaient : plans et programmes, renseignement, exercices, préparation de l’avenir, etc, à un niveau très supérieur à celui fait en France. J’ai essayé de faire comprendre, sans grand succès, qu’à Norfolk les officiers et sous-officiers français développaient des compétences uniques, à un niveau bien supérieur à celui des armées françaises, et qu’ils ne faisaient pas de relations internationales à proprement parler. Les exercices menés dans l’Otan sont bien plus impressionnants que ce que nous sommes capables de planifier et diriger en France. Ces officiers savent monter une opération de grande ampleur. Ils savent travailler avec des partenaires internationaux. Ils savent gérer de grands programmes en coopération, agréger les positions de nombreux pays pour construire une vision de l’avenir ou lancer des projets d’innovation. En réalité, à Norfolk, nous faisions la même chose qu’en France mais à un niveau supérieur, car nous avions une force de frappe plus importante et une vision plus large. Malheureusement c’est très mal reconnu et les officiers ou sous-officiers qui reviennent des structures otaniennes n’ont pas les affectations qui prennent en compte ces compétences. Je le regrette vivement car on passe à côté de quelque chose d’essentiel notamment pour former un vivier de militaires capables ensuite de prendre des responsabilités au sein de l’Europe de Défense.
MMP : Pourquoi ne pas se rapprocher des universités et écoles pour créer des partenariats d’innovation, voire créer des pôles croisant diverses expertises (DGA/entreprises/universités-écoles) ?
DM : C’est une bonne question. Par exemple, le programme Hacking for defense[6] développé par les Américains est un magnifique programme. J’ai pu rencontrer des jeunes extrêmement motivés dans les universités. Le but c’est de se dire que ces gens-là, lorsqu’ils créeront leurs startups, sauront travailler avec la défense. C’est un programme que l’AID devrait lancer, il faut développer cela. Et il faut encourager aussi les écoles militaires à développer des partenariats avec le monde civil. Le problème c’est que nous ne pouvons pas lancer ce type de programme si nous n’avons pas les bonnes structures en place.
L’Ecole navale a été la première, puis l’Ecole de l’air la seconde, à changer d’organisation en devenant des établissements publics. Mais il a fallu une révolution culturelle pour faire passer cette idée. Nous pouvons conclure des partenariats avec les universitaires et les centres de recherche, et il faut que les armées puissent passer des contrats de manière professionnelle avec ces derniers, sinon c’est un vrai frein. Oui il faut investir beaucoup plus dans l’ouverture, les armées ne sortent pas assez de leurs murs. Pour innover, il faut aller intéresser les jeunes dans les écoles d’ingénieurs, les universités, etc. En général, les étudiants ne connaissent pas le monde de la défense. Le monde à l’extérieur des armées ne nous connait pas du tout. Il faut réellement créer des initiatives. Il en existe déjà, mais ce n’est pas suffisant, il faut mener des projets communs. Le rôle de l’Agence de l’innovation est de créer cela, en coopération avec les différents centres des armées, voire de créer un vrai Hacking for Defense français.
MMP : Pensez-vous que du côté des écoles d’ingénieurs il serait possible de créer des partenariats directs d’innovation, ou de créer un lien entre les grands groupes d’industriels et les écoles ?
DM : Dans notre pays où nous avons tout, nous pouvons nous inspirer de ce qu’il se passe aux Etats Unis. D’une part, il faut convaincre ces écoles de venir travailler avec la défense ; et d’autre part, il faut mettre de l’argent sur la table en développant des projets. Mais le problème, en France, c’est que même ces écoles ne sortent pas beaucoup non plus de leurs murs, notamment les grandes écoles qui sont trop cloisonnées. Je suis allé visiter Stanford : au niveau master, pour réussir le projet de fin d’année, il est nécessaire d’associer plusieurs disciplines. Grâce au programme Hacking for Defense, j’ai vu des étudiants très enclins à travailler avec les armées. Il faut que l’AID joue ce rôle et aille voir les écoles.
Quand on a créé la Smart Base d’Evreux[7], notre but était de faire un centre d’innovation à destination des métiers du soutien. Notre objectif était alors d’accueillir plusieurs petites entreprises à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de la base pour créer une pépinière. Cela n’a pas si bien fonctionné que cela, parce qu’il aurait fallu lui donner une vraie impulsion en pouvant passer des contrats et aussi parce que dès qu’on parle de soutien hors opérationnel dans les armées il faut mettre de très nombreux organismes autour de la table. L’écosystème interne est loin d’être constitué ! Mais l’idée était là : c’était d’associer des gens qui ne se connaissent pas, de travailler ensemble et se mélanger pour se poser les bonnes questions. C’est comme les defense unit experimentation aux Etats-Unis : ils ont mis trois comptoirs (Silicon Valley, Austin et Boston) au sein desquels militaires et entreprises startups ou grands groupes se rencontrent, contractualise très vite les idées et développent des prototypes que les armées testent ensuite. C’est lié aussi au programme Hacking for defense, car c’est là que se trouvent les grandes universités, il n’y a pas de secret. Mais on peut le faire aussi en France : prenez Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes… et on a tout.
MMP : Quelle est l’importance du Big Data et de l’Intelligence Artificielle dans le domaine de la défense en France ? Et quels sont les impacts que ces domaines peuvent avoir sur l’innovation ?
DM : L’intelligence artificielle est un domaine qui nécessite une vraie réflexion. Tout le monde en parle aujourd’hui, sans forcément savoir de quoi ils parlent. Mais on en fait presque un objectif alors que la question est là encore : « pour quoi faire ? ». Il faut éduquer les gens sur ce qu’est la continuité numérique, ce qui signifie : quelles sont les données récoltées, à qui appartiennent-elles, à qui sont-elles destinées, où les stocker, qui les extrait, comment les extraire, qui fait les algorithmes, comment les redistribuer et à qui ? Tout cela représente des métiers différents, et pourtant, lorsqu’on parle de Big Data ou d’IA on a l’impression qu’on couvre le tout.
La mauvaise compréhension de la continuité numérique conduit à des analyses erronées des questions stratégiques. Dans ce domaine, un domaine clé pour moi est le cloud. C’est là où sont stockées les données, ce qui est essentiel, pas les algorithmes qui les analysent. C’est l’environnement et l’accès aux données stratégiques en considérant l’ensemble de la chaîne numérique qui doit guider notre analyse. Il ne sert à rien de vouloir recréer des Google, Palantir ou Amazon en France, c’est trop tard. Utilisons leurs compétences, mais en positionnant les entreprises françaises ou européennes dans les domaines de la continuité numérique et dans les expertises où tout reste à développer. Et ces domaines sont nombreux avec des briques technologiques qui souvent existent dans notre tissu de PME ou de startups. Il faut vraiment créer une réflexion autour de ces enjeux avec en tête une réalité : la donnée est une ressource stratégique qui mérite cette réflexion approfondie mais en évitant les slogans trop faciles.
Maintenant pour les armées, il faut se demander ce que l’on peut faire de ces éléments. Nous pouvons avoir une vision tactique fondée sur les systèmes d’armes, en créant par exemple des radars quantiques, en intégrant l’intelligence artificielle dans la guerre électronique, etc. Mais la portée stratégique reste relativement limitée. Ou alors, on étudie comment ces technologies peuvent changer profondément nos concepts d’opérations, et notre manière de fonctionner en opérations dans l’esprit d’une vraie transformation numérique qui portera sur l’agilité de notre chaîne de décision et sur le niveau de déconcentration du contrôle des forces et sur ce que cela implique comme changement. On s’apercevra rapidement que la mise en œuvre d’un tel changement demandera dix ou quinze ans. De toute manière, il s’agit de transformations trop importantes pour les conduire trop rapidement, mais il faut avoir cette réflexion conceptuelle avant tout. Sans réflexion, on va mettre en place des outils numériques avec une vision limitée et peut-être dépenser de l’argent pour pas grand-chose.
Décentraliser le contrôle opérationnel des forces c’est, au lieu d’avoir un chef qui donne des ordres et des hommes qui les exécutent, partir des soldats, des aviateurs, des marins et se demander de quelles données ils peuvent avoir besoin pour prendre quand la situation l’exige le contrôle de forces qui ne leur appartiennent pas et agir avec plus d’agilité. Le commandeur agit alors en soutien de l’opérationnel. C’est cela une transformation numérique : partir du « client » qui est en l’occurrence l’échelon opérationnel et réorganiser la chaîne de commandement en fonction de ses besoins. Cela représente un changement majeur de la structure hiérarchique qui s’appuierait sur une architecture numérique où la donnée est centrale.
Nous avons aussi une vraie réflexion à mener sur les systèmes d’armes car les technologies numériques évoluent très vite.
Dans l’armée de l’Air, nous avons développé grâce au centre d’expertise aérienne militaire, le centre d’innovation opérationnelle de l’armée de l’air, une tablette connectée qui peut récupérer les données du Rafale avec une diode qui empêche cette tablette de s’adresser à l’avion, afin de conserver son intégrité. Ce système permet de programmer la tablette que le pilote amène en vol pour mener des expérimentations qui seront par la suite intégrées au système d’arme du Rafale. Penser l’évolution du système d’arme en tenant compte de technologies numériques aux progrès très rapides est une caractéristique essentielle aujourd’hui de la flexibilité opérationnelle.
Un autre exemple d’innovation : nous voulions concevoir un simulateur afin de former les opérateurs d’appui aérien, les contrôleurs au sol qui guident les avions. Pour les former, il faut des dizaines d’heures de vol d’avions à guider, qui sont coûteuses et pas toujours rentables au plan opérationnel pour les équipages. Nous avons conçu le projet de construire un simulateur, avec l’objectif de le faire valider par l’Otan et de diminuer les heures de vol nécessaires à la formation. Nous avons présenté ce projet à un industriel, qui nous a proposé un devis de plusieurs millions d’euros pour ce type de simulateur. C’était trop cher. Nous avons désigné un lieutenant-colonel à l’état d’esprit innovant, qui s’est associé à une équipe comprenant notamment des sous-officiers programmateurs : ils ont créé le simulateur en utilisant des produits du commerce dont des logiciels de jeu et permettant d’utiliser les vrais équipements emportés par les contrôleurs avancés. Ce simulateur peut même s’interfacer avec de véritables avions en vol. Le coût total s’est élevé à quelques centaines de milliers d’euros. Evidemment, on ne compte pas dans ce coût les heures des militaires passées sur le projet, comme dans le privé. L’OTAN a validé le simulateur et la possibilité de transférer de nombreuses heures de guidage sans utiliser d’avions réels. In fine, cette innovation a fait réaliser de substantielles économies.
Il existe donc de multiples exemples de projets qui, avec un peu d’argent, peuvent aboutir à une véritable innovation. Je fais le pari qu’en donnant un million d’euro à chaque armée et en leur demandant de développer des projets avec l’AID elles puissent nous étonner par leur capacité à innover.
MMP : N’y a-t-il pas une potentielle perte de “rusticité” au profit du développement de la technologie, notamment lorsqu’il s’agit d’augmenter les capacités du combattant en opérations ?
DM : Il y aura toujours des militaires qui refuseront l’intelligence artificielle. Et il faudra toujours former les soldats de manière rustique mais cette question me fait rire. La question que nous devons nous poser est la suivante : « rusticité, mais contre qui ? ». De temps en temps il vaut mieux se replier, avoir un système qui marche et avoir l’avantage plutôt que de s’engager de manière rustique et prendre des risques inconsidérés. Donc ça ne peut pas être un dogme, comme c’est parfois érigé notamment par l’armée de terre.
L’important est de comprendre l’intelligence artificielle, ce qui est très compliqué aujourd’hui. On va parler de plus en plus d’interfaces et de machines qui fonctionnent avec de l’intelligence artificielle ; il faut des hommes capables de comprendre de telles interfaces. Les Américains et les Chinois ont commencé à travailler là-dessus : ils développent la question de l’homme augmenté. Avec de nombreux de sujets qui dépassent l’éthique française, mais ils ont bien compris que développer de l’intelligence artificielle nécessitera des hommes hors du commun. Mon leitmotiv consiste à dire que nous ne pouvons pas développer des systèmes avec de l’intelligence artificielle sans se demander qui va travailler avec, comment nous allons les former, comment augmenter leurs capacités cognitives. Le problème c’est que les autres pays ne vont pas hésiter longtemps : la Chine commence déjà à travailler sur les embryons. C’est un sujet qui dépasse la défense mais qu’il ne faut pas refuser d’étudier sérieusement.
Le problème en France, c’est que nous nous limitons trop souvent en invoquant des problèmes d’éthique. Ceux-ci sont évidemment essentiels mais seulement si l’on comprend de quoi il s’agit. Un comité d’éthique va se créer au ministère : c’est indispensable, mais ce comité ne doit pas travailler sur des cas concrets et surtout pas de façon générique, au risque de rester trop général et donc de tout interdire. Si nous voulons avoir une véritable approche éthique, il faut apprendre. Nous avons lancé à ACT un projet sur les systèmes autonomes avec l’objectif d’avancer sur des cas concrets sur lesquels fonder les réflexions éthiques, réglementaires, ou humaines.
L’intelligence artificielle et les systèmes autonomes sont des technologies très intéressantes et on résout souvent les questions posées en affirmant que l’homme sera toujours inclus dans la boucle de décision. Mais il faut choisir qui est cet homme : le soldat, le leader politique, le chef d’état-major des Armées ? C’est un sujet réellement complexe qui demande l’étude de cas concrets. Et, avant d’imaginer l’usage de la force, il y a de très nombreuses autres applications de ces systèmes notamment pour la logistique.
MMP : Mais l’investissement dans des projets dont la concrétisation serait entravée par le refus d’un comité d’éthique ne constituerait-il pas une perte trop importante de moyens et de crédits ?
DM : Si nous ne voulons pas perdre d’argent, alors n’innovons pas. Mais ces projets en général ne coûtent pas si cher, on ne va pas se lancer dans le développement d’un système d’armes complexe et s’arrêter. Je crois en la vertu du démonstrateur, qui doit être simple afin d’expérimenter les idées. Le développement de jumeaux numériques s’inscrit dans cette nécessité de tester les systèmes en réel mais par des scénarios numériques, pour justement rendre les solutions moins risquées. Il faut utiliser toutes les voies et les technologies qui permettent d’ « apprendre en marchant », c’est la clé de l’innovation.
Notes:
[1] Commandement suprême des forces alliées en Europe ou, en anglais, Supreme Allied Commander Europe.
[2] Commandement suprême allié Transformation ou, en anglais, Supreme Allied Command Transformation.
[3] La Defense Advanced Research Projets Agency (DARPA) fait partie du département de la Défense des Etats-Unis. et a pour vocation de soutenir la recherche et le développement de nouvelles technologies à des fins militaires aux Etats-Unis.
[4] Le système de combat aérien du futur (SCAF) est un projet rassemblant la France, l’Allemagne et l’Espagne, dont l’ambition est de développer un « système de systèmes » autour d’un avion de combat nouvelle génération à l’horizon 2040.
[5] Le programme SCORPION, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Direction générale de l’armement, tend à assurer la modernisation des groupements tactiques interarmes. Il comprend notamment la rénovation des chars Leclerc, le développement des nouveaux véhicules blindés (GRIFFON, JAGUAR et SERVAL).
[6] Programme développé par l’université de Stanford, et étendu à plus d’une vingtaine d’universités américaines.
[7] Ce concept a été créé en juin 2015 sur la base aérienne 105 d’Evreux et consiste notamment à « à ouvrir la base pour mieux exploiter le capital qu’elle renferme en recherchant, par le biais de l’innovation, à nouer des partenariats. » (https://www.defense.gouv.fr/actualites/la-reforme/lancement-de-la-premiere-smart-base-a-evreux).