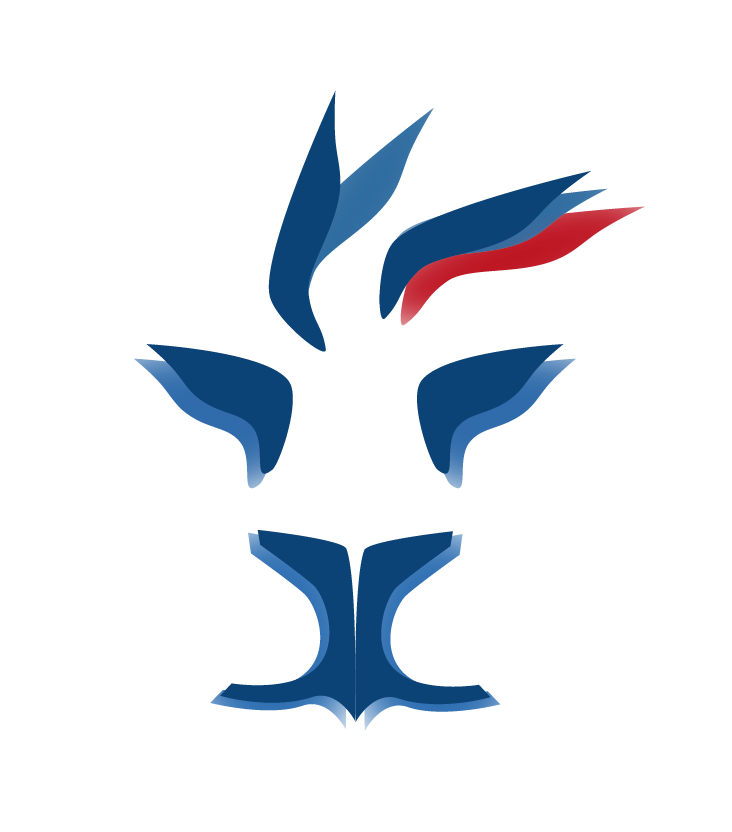Propos recueillis par François-Emmanuel Lacassagne

M. Jérôme Poirot a été adjoint du coordonnateur national du renseignement. Il est l’auteur avec le préfet Hugues Moutouh d’un Dictionnaire du renseignement, récemment publié chez Perrin.
Nous le remercions chaleureusement de nous avoir accordé cet entretien.
Sur le dictionnaire du renseignement et l’historiographie du renseignement
Nemrod : Le dictionnaire du renseignement est le premier ouvrage écrit sur le sujet par des professionnels, et destiné au grand public. Pouvez-vous présenter la genèse de cet ouvrage ?
J.P: C’est une idée de Benoît Yvert, patron de Perrin, qui pensait qu’il manquait un ouvrage de ce type ; il en a parlé à Hugues Moutouh, qui m’en a parlé. Nous avons d’abord constitué un comité de rédaction incluant quelques docteurs et des étudiants en doctorat travaillant dans les services. Nous sommes arrivés à un comité de six – dont Hugues Moutouh et moi-même. Nous pensions réaliser ce travail en trois ans, ce qui est long, et l’avons finalement fait en cinq ans.
La première tâche a été de constituer une liste des entrées. L’éditeur souhaitait que nous abordions le renseignement sous tous ses aspects – l’organisation des services, l’histoire, le droit, les grandes opérations, les grandes figures, la fiction. Nous n’étions pas forcément toujours d’accord sur les entrées à retenir. Nous avons écrit, organisé des réunions périodiques pour critiquer collectivement le travail déjà effectué. Cela a été long, puisque nous travaillions par ailleurs et qu’il y avait des contributeurs extérieurs, mais nous sommes contents du résultat !
Le renseignement occupe une place importante dans l’opinion publique – que cette place soit ou non fantasmée. Pensez-vous que le renseignement doit aujourd’hui faire preuve de davantage de pédagogie pour s’expliquer sur son action ?
Je ne sais pas si les termes « pédagogie » et « s’expliquer » conviennent ; je pense en tout cas que les services doivent s’ouvrir davantage, à la fois aux parlementaires – ils le font –, aux journalistes, et à l’opinion publique. Le degré d’ouverture dépend de la culture des services. La DGSI a toujours la culture de la DST – le secret absolu – qui évidemment a une grande vertu dans le monde du renseignement, mais qui rencontre une certaine limite dès lors qu’il s’agit de l’opinion publique.
Pour ce qui concerne la DGSE, cela dépend essentiellement de qui est à la tête du service. Bernard Bajolet avait institué un marronnier tous les étés avec le Figaro Magazine. Tout cela était très bien pensé, très bien fait, très utile. Il existe depuis le mois de mai 2018 une chaîne Youtube de la DGSE, dont la vocation première est d’attirer des talents. Le directeur général actuel – quoique je n’en aie jamais parlé avec lui – est dans une perspective d’ouvrir davantage. Je pense qu’il est convaincu que ces choses sont nécessaires pour légitimer davantage l’action du service, le faire connaître plutôt sous son meilleur jour, et faire de l’influence. Il s’agit au fond d’influence classique à la fois vis-à-vis des cercles de pouvoir, des cercles de réflexion et de l’opinion publique.
Les services s’ouvrent donc progressivement. On est très loin encore de ce que font les Américains ou les Britanniques. Je pense que l’idée de confier à un historien la rédaction d’une histoire des RG jusqu’en 1965 ou 1970 serait très utile ; une histoire de la DST jusqu’en 1970 ou 1975 serait très utile aussi. L’histoire est aussi un irremplaçable instrument de connaissance des services eux-mêmes. Tout ceci se fera, je ne sais exactement quand.
Si l’on résume, l’idée de s’ouvrir vise donc à la fois à proposer une vision de l’histoire des services, et en même temps d’attirer des talents, comme on a pu le voir avec le Bureau des légendes…
Tout à fait. C’est aussi légitimer l’action des services, c’est aussi prendre la place qui sinon serait occupée par des gens moins savants, moins lucides, ou moins bienveillants. C’est aussi l’un des objectifs de notre ouvrage : occuper la place.
Histoire du renseignement
Certains historiens anglo-saxons, comme Richard Aldrich, critiquent le fait que les archives des services de renseignement soient parfois présentées « en ordre de parade ». Selon cette idée, le choix que les services de renseignement opèrent dans la matière qu’ils donnent aux historiens influencerait le récit qui serait rédigé. Qu’en pensez-vous ?
S’agissant du cas français, il y a une loi sur les archives, qui crée non seulement l’obligation de verser, et qui crée le cadre de ce que l’on verse. Il y a ensuite la pratique : dans toutes les administrations il y a des conservateurs, des conservateurs en chef ; il y a donc un dialogue avec eux. On ne doit pas tout verser, de très loin, nous n’avons pas vocation à encombrer les archives. Il faut faire preuve de discernement dans ce que l’on verse.
Il est vrai qu’il y a toujours une possibilité d’appréciation, sur les choses qu’on verse – dont on peut penser que ce ne sont pas toujours des choses indispensables – et sur les choses qu’on ne verse pas – pensant que ce ne serait pas nécessairement la bonne interprétation de la loi. Il est donc évident qu’il y a un jeu avec ça. Dans ces domaines là, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas versables, qui sont simplement dans la mémoire des gens.
On peut faire cette critique et ce procès aux services de renseignement qui versent ou ne versent pas leurs archives, mais il faut demeurer raisonnable.
Prenez par exemple le très bon livre qui a été fait sur les archives Foccart[1] : il apporte beaucoup de choses sur le renseignement. Je ne savais par exemple pas que le bureau réservé avait été créé à la demande de Foccart. L’exploitation des archives des services français sera donc une mine pour l’histoire.
Il est vrai qu’en France, l’administration n’a pas toujours la culture du versement des archives. Dans une collectivité locale, on m’a un jour dit : « cela fait cent ans que telle direction n’a pas versé ». A la décharge des acteurs, on n’apprend ça nulle part : dans les écoles publiques de fonctionnaires, il n’y a pas deux heures, ou une demi-journée, qui soient consacrées à ce sujet. C’est à la fois étonnant et regrettable.
Le renseignement en démocratie
On se pose souvent la question des renseignements en démocratie ; il s’agit de savoir comment on garantit les libertés individuelles, tout en permettant aux renseignements de continuer leur action. Pensez-vous qu’il soit possible d’encadrer le renseignement par le droit ?
Tout ce que je puis dire sur ce point, c’est qu’il faudrait sans doute utiliser davantage l’inspection des services. Il s’agit d’un outil formidable. Tout cela demeure dans les mains de l’exécutif.
Que pensez-vous des commissions de contrôle parlementaire, telles qu’on peut les observer aux Etats-Unis ?
Le cas américain est très intéressant car il montre que ni la loi – et il y a des lois qui encadrent tous les domaines du renseignement – ni le contrôle parlementaire – qu’il s’agisse des select committees ou du congrès dans son ensemble – ne sont suffisants pour encadrer parfaitement le renseignement. Il y a de nombreux projets des services qui n’ont jamais abouti faute de budget voté par le congrès : quand la DIA[2] voulait avoir un service clandestin, le congrès lui a par exemple refusé.
Je suis tombé récemment sur une décision du congrès à la fin des années 1970 : les congressmen se sont aperçus qu’il existait des redondances entre la NSA et la CIA. Le congrès, dans sa fonction de contrôle budgétaire, a alors jugé que l’argent était mal dépensé. Il a donc obligé les deux services à se coordonner, et a fait en sorte que le tout soit placé sous l’autorité de la NSA.
Il peut y avoir des contrôles parlementaires – chez nous il sont encore en cours de maturité. Mais ni la loi, aussi intelligente soit-elle, ni le contrôle parlementaire, aussi divers et précis soit-il comme c’est le cas aux Etats-Unis, ne prémunissent contre certaines dérives. Je ne dis pas ici que le sujet est insoluble, mais il faut trouver les méthodes les plus adaptées à notre culture juridique, judiciaire, à la culture des services, à notre culture de la sécurité nationale et de la raison d’Etat.
La structure des renseignements français
Pouvez-vous présenter le rôle et la fonction du coordonnateur du renseignement ?
Je vous renvoie à la notice sur le CNR dans le dictionnaire. Le CNR est mal né parce qu’il est né trop tard : il a été créé plus d’un an après la prise de fonction de Nicolas Sarkozy, et la mise en place de l’essentiel des nouvelles dispositions dans le domaine du renseignement, donc les habitudes, étaient prises. Bernard Bajolet a beaucoup fait pour asseoir l’autorité du coordonnateur, je me suis battu à ses côtés sur certains sujets ; cela n’en demeure pas moins très difficile.
L’autorité du coordonnateur est maintenant considérable. Pierre de Bousquet de Florian, l’actuel coordonnateur du renseignement, dispose aujourd’hui de la confiance du président.
Pour réussir à coordonner les services, est-ce que d’autres moyens pourraient être utilisés, ou est-ce que le CNR est le meilleur ?
Le meilleur garant de l’efficacité globale du dispositif, du fait que les services travaillent de plus en plus les uns avec les autres, c’est le coordonnateur. Encore faut-il que le président de la République souhaite qu’il ait du poids. C’est en particulier le cas depuis l’élection d’Emmanuel Macron.
Qu’en est-il des structures de partage de l’information entre les différents services ?
C’est autre chose, il y a d’une part la coordination des services et d’autre part la coordination opérationnelle. Il faut, lorsqu’on pense que c’est utile, mettre de tels dispositifs en place. Il y a la cellule ALLAT de la DGSI par exemple.[3] Les choses, depuis 2008, se font de plus en plus en commun, certaines sont publiques comme l’ALLAT, beaucoup ne le sont pas. La tendance est claire ; nous sommes sur un chemin très vertueux. La culture des services a changé, tout comme l’approche des directeurs de services. Pour plusieurs raisons : la réforme de 2007-2008 a joué, les hommes ont changé, le retour du terrorisme crée des obligations particulières, l’académie du renseignement, un outil formidable, a favorisé ces dynamiques…
On mesure difficilement, lorsqu’on est extérieur à la communauté du renseignement, les progrès considérables qui ont été accomplis en dix ans.
Quel fut l’impact de la fusion des RG et de la DST sur la qualité du renseignement territorial ?
On a perdu dans une certaine mesure, un maillage territorial ; cette réforme s’explique de différentes façons. Le problème a été rectifié progressivement : ce n’est plus une sous-direction, c’est un service, c’est très bien. Il est placé au sein de la direction de la sécurité publique, ce qui n’est pas forcément une bonne chose : il mériterait d’être directement rattaché au ministre. Mais il ne faut surtout pas croire que c’est la réforme qui explique le retour des attentats. Cela a peut-être rendu plus difficile la connaissance par les préfets – et par conséquent par le gouvernement – de leur environnement.
Le rôle des services et leurs méthodes
Les temps sont aux menaces hybrides, et notamment de ce que l’on a appelé la « guerre informationnelle ». Diriez-vous que les services de renseignement jouent de ce fait un rôle plus important que par le passé ?
Ce sont des menaces, donc les services s’occupent des menaces. Ces menaces sont de plus en plus aigues, donc notre activité est proportionnelle à la nature des menaces et aux risques qui sont posés pour notre sécurité nationale.
Certains moyens, notamment financiers, vous semblent-ils avoir été redirigés des moyens conventionnels vers les moyens de renseignement ?
Non. Le budget de la communauté du renseignement augmente chaque année depuis 2008. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu une direction qui ait vu concomitamment son budget baisser pour une raison X ou Y. Ces hausses budgétaires illustrent un accent clair porté sur le renseignement. Il ne s’agit toutefois pas de transferts, qui iraient de l’armée conventionnelle vers le renseignement.
Le rôle des renseignements devant l’opinion
Dans un article que vous avez écrit avec Hugues Moutouh[4] vous indiquez que les Offshore Leaks pourraient être le produit d’une opération américaine visant les milieux financiers russes proches du Kremlin. Avez-vous à l’esprit quelques exemples historiques établis dans lesquels les journalistes ont été pour ainsi dire les « idiots utiles » ou les agents d’influence de services de renseignement étrangers ?
Depuis qu’il y a des services, et depuis qu’il y a des journalistes. Le dictionnaire est plein de tels exemples. Pour l’article auquel vous faites référence, nous émettons des hypothèses, nous raisonnons. Nous pensons que nos hypothèses sont solides ; elles n’en sont pas pour autant issues de secrets que nous détiendrions par ailleurs. Ce sont simplement des raisonnements faits sur la base d’éléments qui nous paraissent trop beaux pour être vrais.
Lorsque vous faites de l’influence, de la désinformation, ou de la manipulation, ce qui est le cas de tous les services dans le monde, l’un des vecteurs de votre action dans ce domaine est forcément les médias, ou maintenant les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux ont-ils changé la nature de ces opérations ?
On leur prête beaucoup…
Politique étrangère
En principe, les renseignements extérieurs constituent l’un des bras armés du pouvoir exécutif. Comment analysez-vous le « divorce » entre le président Trump et la CIA, notamment marqué par les déclarations de cette dernière à propos de l’affaire Khasoggi ?
Je pense qu’il faut regarder les choses plus globalement. Les relations, me semble-t-il, entre le président Trump et les administrations sont assez différentes de ce qu’elles ont pu être pendant longtemps aux Etats-Unis. Les sujets qui concernent la politique étrangère ou la CIA étant peut-être plus sensibles, ils sont particulièrement visibles.
Lorsqu’on voit le nombre de postes dans les administrations qui doivent être confirmés par le Congrès, une proportion importante n’a soit pas fait l’objet de propositions, soit pas été encore confirmée. Donc le fait qu’il existe un type de relation nouveau entre le Président et les administrations n’épargne pas la CIA. Ce qui est effectivement assez étonnant dans le cas que vous citez, c’est que de tels désaccords aient été rendus publics.
Dans la perspective de la lutte contre un terrorisme mondialisé et transfrontalier, la coopération internationale de manière générale, et européenne en particulier ne cesse d’être avancée. Quelles en sont les perspectives ?
Les pièces du puzzle dont vous parlez sont assemblées dans le cadre de coopérations intergouvernementales. Tout cela fonctionne de mieux en mieux. Je n’arrive pas à comprendre l’idée selon laquelle il faudrait un FBI à l’échelle de l’Union. Même dans un champ étroit comme la lutte antiterroriste, il faudrait que les Etats arrivent à se mettre d’accord. Or il existe par exemple des pays dans lesquels la menace terroriste islamiste n’existe pas.
Quel en serait le cadre juridique ? C’est comme la question de la défense européenne : on ne fait pas la guerre pour le plaisir de faire la guerre ; on fait la guerre lorsqu’on estime qu’il n’y a pas d’autre solution. Pour qu’il y ait une armée européenne il faudrait donc qu’il y ait une politique étrangère européenne. Je ne vivrai pas cela, et sans doute vous non plus…
L’ampleur des coopérations qui existent entre les Etats dans le domaine antiterroriste est très peu connue, mais de très nombreuses choses sont faites, et c’est heureux. Dans ces domaines là, on ne coopère que quand on y a intérêt. En matière antiterroriste par exemple, beaucoup d’Etats trouvent qu’ils ont intérêt à coopérer, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral.
Boutros Boutros-Ghali avait tenté dans les années 1990 de doter l’ONU d’un service de renseignement autonome…
On n’a pas même réussi à se mettre d’accord au sein de l’ONU sur une définition du terrorisme[5]… Pensez-vous qu’on parvienne à mettre en place un organe de renseignement ?
SOURCES ET REFERENCES :
[1] J-P Bat, Olivier Forcade, Sylvain Mary (dir). Jacques Foccart : archives ouvertes (1958-1974), la politique, l’Afrique et le monde, PUPS, 2017 (NDLR)
[2] Defense Intelligence Agency, l’agence de renseignement militaire américain (NDLR)
[3] « La DGSI a initié une coordination en créant à l’été 2015 Allât, sa propre cellule interne de coordination opérationnelle. Fer de lance des ambitions coordinatrices de la DGSI, et sans lien aucun avec l’UCLAT, cette cellule qui rassemble 9 services (notamment DGSI, DGSE, DRM, DRSD, DGGN, SCRT, DRPP) a une vocation très opérationnelle axée sur le sujet irako-syrien, échangeant sur des objectifs et des dossiers spécifiques en lien avec la situation de terrain ». (Nathalie Cettina, Les nouvelles figures de proue de la lutte antiterroriste, Note de réflexion n°24/ Décembre 2017, Centre Français de recherche sur le renseignement.)
[4] Jérôme Poirot, Hugues Moutouh, « Espionnage et contre-espionnage dans le cyberespace », Politique Internationale, n°160, été 2018.
[5] Communiqué de presse SG/SM/10242 du 1er décembre 2005 ; les négociations avaient alors achoppé sur la question de « la référence aux principes de base du droit international et plus particulièrement sur le droit à l’autodétermination et le droit à résister à l’oppression » (source : https://news.un.org/fr/story/2005/11/83082)