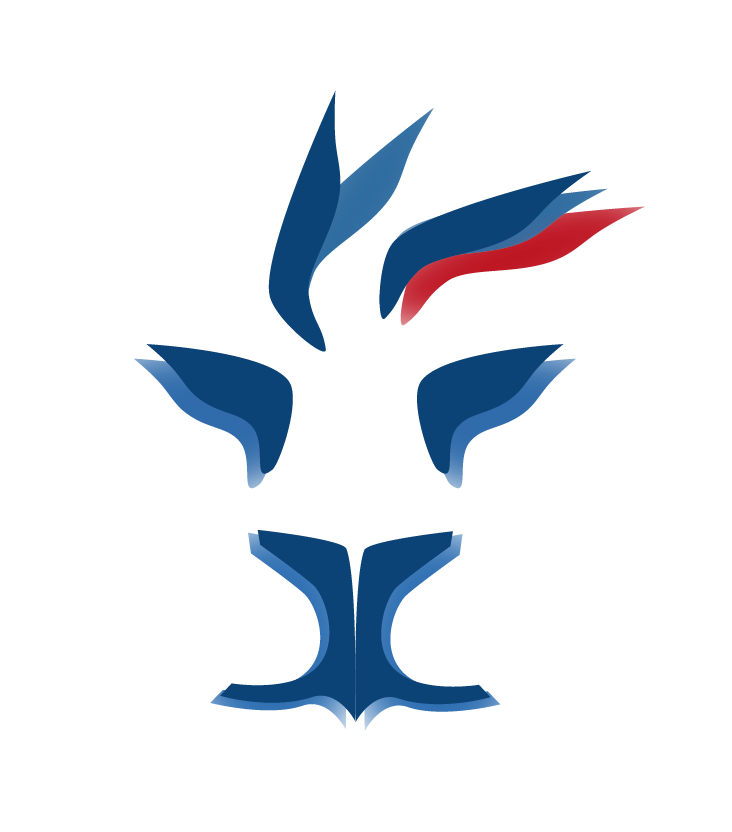Laurent de Jerphanion
Ancien élève de l’Ecole navale, qu’il a rejointe en 1986, Laurent de Jerphanion est également breveté de la Royal Navy (« Principal Warfare Officer »), du Ministry of Defence (« Royal College of Defence Studies ») ainsi que de l’Ecole de Guerre (2003). Capitaine de vaisseau, il fut notamment directeur de cabinet du préfet maritime de l’Atlantique (2007-2010) puis commandant de la frégate « Jean Bart », qui s’est distinguée par son engagement opérationnel, dans le cadre de l’opération Harmattan, au cours de la crise libyenne en 2011. Laurent de Jerphanion est actuellement chargé du développement de ligne de produits Naval et Energie chez l’industriel Thales.
L’équipe de Nemrod tient à remercier chaleureusement Laurent de Jerphanion pour cet entretien et la qualité de ces échanges. Les points de vue exprimés lors de cette rencontre n’engagent que leur auteur et ne représentent en aucun cas ceux de la Marine nationale ou de Thales.
Entretien réalisé par Sara Valeri et Solène Moitry le 12 décembre 2018 à Paris.
Quel regard portez-vous sur les évolutions récentes en matière de défense européenne, notamment les initiatives communautaires vis-à-vis de son industrie de défense ? Y a-t-il une Europe de la défense par le marché ? Envisagez-vous la possibilité d’une volonté politique commune en matière de défense ?
C’est un sujet intéressant que je vais aborder dans son aspect capacitaire et opérationnel. Du point de vue opérationnel, que feraient les armées au sein de la défense européenne ? Pour être franc, je ne crois malheureusement pas à une défense européenne à horizon visible, mais je crois à une défense de l’Europe. Pourquoi cela ? Vous l’avez dit, il faut une volonté politique, une union politique, et tant qu’il n’y en a pas, il y aura toujours des intérêts divergents à un moment donné. Donc, avoir, au niveau de la défense qu’on appelle « européenne », une brigade franco-allemande, un corps européen, une force navale franco-allemande, des forces de l’Union européenne navales, c’est très bien parce que cela permet aux militaires de travailler ensemble et, lorsque le politique veut intervenir ponctuellement dans un cadre européen, d’envoyer des unités sous un drapeau européen (tout en gardant leur drapeau national), donc d’afficher une volonté politique. Le moins-disant donne les limites : on ne va pas aller vers une intervention militaire forte, immédiate, parce qu’il faudrait que tout le monde s’accorde, et sur les objectifs, et sur les moyens. Cette unanimité requise limite donc la capacité de réaction rapide face à une crise, sauf si c’est une crise humanitaire.
En plus, pour certains pays comme l’Allemagne, toute intervention militaire doit passer devant le Bundestag[1] et cela prend du temps. Certes, le Danemark, qui a opt-out[2] sur la défense européenne, a le même principe : quand la France est rapidement intervenue au Mali en 2013[3] afin de prévenir l’installation d’islamistes à Bamako, nous avons demandé des moyens à nos alliés européens, car même si nous avions des opérations coup-de-poing possibles, nous avions notamment des besoins logistiques de transport. Les Britanniques nous ont prêté un avion et les Danois nous ont dit : « on est dimanche, or on a besoin de l’autorisation du parlement… Néanmoins on a un avion en entraînement en Europe ; on va le poser chez vous comme ça lundi matin il sera prêt ». Et le lundi matin, on avait le feu vert. Même un parlement peut, entre un dimanche et un lundi matin, valider une décision de mise à disposition de moyens pour l’intervention militaire à l’extérieur, s’il en a la volonté. Sous-entendu : je ne pense pas que le parlement allemand ait la volonté d’agir réellement – pour des raisons historiques bien connues.
Donc le verrou parlementaire n’en est pas un s’il y a une volonté. Et des pays opt-out de la défense européenne comme le Danemark peuvent révéler de très bonnes surprises en étant prêts à s’engager lorsqu’ils ont compris l’enjeu. De nouveau, chaque pays doit analyser l’enjeu et s’accorder sur la réponse à apporter à ce défi. C’est pour cela que « défense de l’Europe », oui, mais « défense européenne »… tant que l’on n’aura pas un gouvernement européen et un Etat européen réel, non.
Cependant, il y a des succès : la lutte de l’Union européenne contre la piraterie dans l’Océan Indien en est un. En utilisant les mécanismes sur une mission qui n’est pas complètement militaire, elle a réussi à mettre en place une mission avant que l’Otan ne réagisse (alors même qu’on présente l’Otan comme l’« alliance suprême »)… Cela montre que face à certaines menaces, s’il y a unanimité des réactions des pays impliqués, et si les mécanismes existent — en l’occurrence la politique européenne de sécurité et de coopération [PESC] — on peut avoir quelque chose d’efficace. Un exemple simple qu’on cite souvent : vous prenez cinq bateaux de pays différents qui ont l’habitude de travailler ensemble (les bateaux militaires travaillent toujours dans un environnement international), cela se passe très bien. L’avantage de l’Europe à l’époque, c’est qu’on avait une réponse légale, que n’avait pas l’Otan, concernant le traitement ultérieur des pirates, et qui était pris en compte. C’est une force de l’Europe : c’est une machine compliquée et agaçante mais elle a des facettes qui permettent de traiter les problèmes complètement et réellement.
Le côté négatif de l’Europe – et là, je quitte la Marine pour aller dans l’Armée de terre – c’est qu’on prétend envoyer une mission européenne de formation au Mali ; or pour certains pays outre-Rhin qui envoient des troupes là-bas, la première et quasi-unique préoccupation, c’est comment créer et défendre leur propre camp. Donc on arrive à une situation où des pays-membres mettent des moyens pour se défendre avant de mettre des moyens sur la mission. Il faut se défendre pour une mission mais il ne faut pas que l’un oblitère l’autre, ce qui est la dérive actuelle. Pour synthétiser, le défaut, c’est que certains pays (car ce ne sont pas les armées mais les pays) n’ont pas la même conception de la prise de risque nécessaire dans le métier militaire. Je suis désolé, mais quand on va au combat, oui, on risque sa peau. C’est dur mais c’est vrai. Voilà pour le côté militaire.
Ce à quoi je crois, ce sont des missions de coopération européenne type Sophia, même si les effets de Sophia face au trafic de migrants sont mesurés. Il y a aussi la lutte contre la piraterie dans l’Océan Indien. Face à des crises de moyen niveau, cela marche bien. Face à une crise plus volumineuse, plus importante, qui demande une réaction forte et rapide, l’Union Européenne sera trop lente à se décider, même si certains pays ont les moyens et la volonté. En plus, certains pays européens n’ont pas nécessairement les moyens et la volonté d’aller livrer le combat (non pas face à des pirates avec des lance-roquettes, mais face à des canons ou missiles).
Tout ce qui est de l’ordre de l’institutionnel militaire, de l’état-major européen, c’est très bien ; il faut que cela existe. Sinon, on ne progresse pas. Ne nous voilons pas la face : cet état-major n’a pas une efficacité opérationnelle réelle. Mais oui, il est indispensable : c’est l’une des briques pour construire peu à peu et avancer vers une défense de l’Europe.
La France n’est pas non plus exempte de tout reproche. Ce que nous disent nos alliés, c’est : « Attendez, vous foncez bille-en-tête et puis vous me dites ‘venez m’aider maintenant’ ». On manque sans doute de l’art d’expliquer en amont. Pour autant, il y a des moments où s’il l’on n’allait pas assez rapidement, rien ne se passerait. Il faut peut-être faire plus d’efforts pour être présents dans la structure de l’Union européenne, mais aussi dans la structure face aux autres pays européens.
Autrement dit, expliquer en amont de toute crise pourquoi coopérer, quels sont nos objectifs. Au niveau opérationnel, les choix français en Europe sont très clairs : essayer de s’appuyer alternativement sur le Royaume-Uni ou l’Allemagne. Le Royaume-Uni parce qu’ils sont forts au combat, même s’ils sont dans une passe basse ; l’Allemagne parce que c’est notre voisin outre-Rhin, même si elle ne veut pas vraiment aller au combat. Ensuite, on décide d’agréger à cela d’autres petits pays. Vous connaissez le mécanisme : la Belgique, l’Espagne, l’Italie (les Pays-Bas, on a du mal)… Toutes ces initiatives donnent une idée de chaos et sont compliquées à comprendre, mais elles sont importantes parce qu’on peut espérer un jour, même si cela prendra du temps, coaguler toutes ces initiatives et faire quelque chose de plus gros.
Quand on a quelque chose qui marche (je pense typiquement aux actions conjointes de combat maritime avec les Britanniques), cela attire d’autres pays. On a des exemples : dans le cas d’un corps expéditionnaire franco-britannique naval (une task-force navale) avec porte-avions, BPC, un peu de doctrine, un peu de coopération, on a vu les Néerlandais, qui sont très pragmatiques, vouloir toquer à la porte. C’est bon signe. Ensuite il faut comprendre pour la défense de l’Europe qu’un certain nombre de pays sont allergiques à une structure qui, selon eux, les emprisonne. Le Royaume-Uni en est un exemple bien connu, mais le Danemark aussi.
Et puis dernier point, complètement politique (c’est un secrétaire d’Etat allemand à la défense qui me l’a dit), l’Allemagne cherche un parapluie pour s‘abriter. On parle notamment du côté nucléaire mais pas uniquement. Entre le parapluie américain et le parapluie français, ils choisissent le plus gros. Donc il ne faut pas être surpris, nous, Français, même si ça nous agace. C’est un exemple parmi d’autres pays qui sont dans la même logique : ils savent qu’ils ne peuvent pas assurer leur défense complète ni agir seuls sur ce qui se passe dans le monde, donc ils cherchent à se mettre dans le sillage du plus fort, pourvu qu’il leur convienne à peu près (car il y a toujours des décalages). Nous aurons du mal à réaliser une défense européenne tant que cette logique demeurera de se tourner vers l’américain en disant : « oui, il affaiblit mon industrie de défense, oui, il fait des choses qui m’agacent parfois, mais tant pis, j’y vais, parce que finalement ça me convient ».
Ce qui explique le choix belge d’acheter les avions de chasse américains F-35 ; choix qui a quelque peu surpris…
Bien sûr, même si nous avons été déçus plus que surpris. Nous le redoutions, mais nous avons été surpris parce que nous arrivons tout de même à un certain nombre de coopérations avec les Belges ; notamment, il y a des années, sur la construction de chasseurs de mines tripartites néerlando-franco-belges. Je pense qu’en France, on a le défaut de croire que lorsqu’on entre en coopération, c’est fait, nous sommes frères pour la vie. Malheureusement non.
Pensez-vous que c’est un défaut exclusivement français, et non européen ?
Si par « européen », on entend les gens qui sont à Bruxelles, alors oui ; mais pas des Etats-membres. La Pologne est un très bel exemple de suivisme vers l’Amérique.
Voilà pour le côté opérationnel.
Pour le côté industriel, on se dirige vers une industrie de la défense européenne, mais cela va être sanglant. Actuellement, nous sommes en surcapacité de production navale au niveau européen parce que nos budgets réduisent par rapport au coût des bateaux, donc on commande moins de bateaux qu’avant – quand je dis « on », c’est toute l’Europe, même si certains pays essaient de remonter en puissance. On a une capacité supérieure à ce que l’Europe peut acheter, donc il y a des chantiers navals qui vont devoir fermer, réduire. Dernier exemple en date : un chantier naval britannique qui dépendait de Babcock BAE Systems vient de mettre la clef sous la porte ; ce sont 300 emplois supprimés. Et pourtant, ils avaient travaillé pour le porte-avions britannique Queen Elizabeth 2.
Au niveau électronique, c’est la même chose, il y a beaucoup trop de concurrence. Quelle est la réponse qui se dessine ? Il y en a deux : vous avez des rapprochements, typiquement Naval Group et Fincantieri… qui sont aussi sous pression politique : Naval Group ne voulait pas recommencer une coopération ou une fusion avec n’importe qui, ayant vécu les frégates Horizon puis les FREMM de façon douloureuse ; après cela parce que les bateaux ont été vendus mais les coûts ont été supérieurs à ce qu’on imaginait… On dit toujours que la coopération fait gagner de l’argent mais c’est faux : le découpage de production se fait selon des choix qui ne sont pas seulement industriels mais aussi très politiques, et chaque pays défend sa propre industrie. A présent, Naval Group se rapproche de Fincantieri. On en parle beaucoup mais concrètement, il ne s’agit pas d’une structure de fusion-acquisition pour le moment ; il s’agit d’afficher une volonté. La position de M. Guillou, PDG de Naval Group, c’est de coopérer « au coup par coup ». Un coup dans l’industrie navale, ça dure longtemps, ça peut être des engagements tout à fait dimensionnants. Mais il ne s’agit pas de fusionner ensemble les deux entreprises.
Au-delà du rapprochement, une deuxième réponse, c’est le rachat. Un exemple : TKMS[4], chantier allemand, avait racheté un chantier naval suédois de sous-marins, ce qui paraissait bien. En fait, en 2015, soit quelques années plus tard, la Suède a re-nationalisé ce chantier naval. Pourquoi ? TKMS avait retiré toutes les commandes à ce chantier naval suédois parce qu’il l’avait racheté pour le tuer, pour supprimer un concurrent. Le monde de l’industrie est un monde cruel et les Allemands ne sont pas les derniers à dégainer.
Pensez-vous que c’est ce qui se dessine avec le Fonds européen de la défense ?
Non, ce qui se dessine avec le Fonds européen de la défense, c’est que les industriels vont s’arracher les uns les autres pour essayer d’avoir les miettes. C’est très bien d’avoir un Fonds européen de défense. C’est un mécanisme très vertueux, mais ce n’est pas ça qui va créer une fraternité entre industriels. Le problème d’un industriel, c’est la survie de son entreprise. Je parle bien de « survie » parce que la concurrence est rude face aux Européens, aux Américains, aux Russes, mais aussi aux Turcs qui se mettent sur le marché. Et dans cet environnement où, certes nous avons de la technologie, mais nous avons du mal, nous Européens, à avoir des gens qui se dirigent vers les carrières technologiques, c’est un défi de recruter des gens de bon niveau.
Or si vous n’avez pas la technologie, et puisque les prix de production sont élevés, vous n’êtes pas du tout concurrentiels par rapport à des pays comme la Turquie où l’heure travaillée est à un prix bien plus bas. Je pense donc que les alliances se feront entre entreprises complémentaires, mais entre celles qui sont sur le même créneau, ce sera la guerre. Et ça se terminera éventuellement, comme toute guerre, par un traité de fusion-acquisition (une joint-venture). Le Fonds européen de défense ne changera rien à cela, mais il incite les pays industriels à se mettre ensemble pour coopérer.
Vous disiez précédemment que la coopération pouvait générer plus de dépenses. Or c’est une critique qu’on a pu adresser au Fonds…
Cela peut créer plus de dépenses mais tel que je vois le Fonds européen de défense, c’est un moyen de policer quelque peu la guerre entre industriels.
Et un moyen d’aider les petites et moyennes entreprises marginalisées…
Les petites entreprises n’auront pas les moyens de s’aligner sur des projets du Fonds européen de défense. Une TPE (Très Petite Entreprise), elle, est en survie permanente. Elle peut avoir un bon carnet de commandes mais elle a besoin d’avoir du flux financier. Elle ne peut pas vivre qu’avec le Fonds européen de défense dont les projets s’étalent sur plusieurs années (il faut monter et déposer un dossier, passer commande tous les six mois… ). Cela nécessite du temps et des moyens ; or si elle se consacre là-dessus, elle n’ira pas sur un marché qu’elle peut gagner plus rapidement avec une autre grosse entreprise à qui elle va vendre ses produits. Dans le domaine naval, le chantier Piriou à Concarneau est un très bel exemple de développement : il y a cinquante ans, il faisait simplement des petits bateaux de pêche, et maintenant il fait même des patrouilleurs, des supply-ship, il travaille au Vietnam, en Afrique… Pour leur croissance, ils se sont alliés à Naval Group pour créer Kership. Cela montre que même si vous possédez le savoir-faire et la volonté, vous rencontrerez nécessairement un problème de croissance à un moment donné. C’est comme une pompe qu’il faut amorcer : si vous la montez trop, vous déséquilibrez votre trésorerie et c’est compliqué ensuite.
Donc je ne pense pas que ce soit le Fonds européen de défense seul qui puisse aider les TPE ou PME. Cela peut les aider par contrecoup, mais elles ne vont pas pouvoir s’aligner en autonomie. Je peux me tromper, et puis il y a toujours des niches. En matière d’IT [Information Technology], SS2i etc., les entreprises ont moins de lourdeur industrielle parce qu’elles produisent du logiciel, des solutions informatiques. Mais c’est quand même assez rare. Et puis surtout, ce sont des entreprises qui vont voir les grandes entreprises lors de salons industriels pour leur proposer des solutions sur un petit créneau que la grosse entreprise n’a pas développé. Lorsque les deux coopèrent sur un appel d’offres, la petite entreprise n’a donc pas à supporter les coûts de démarchage de client, de négociation du contrat ; elle a juste à passer un contrat plus rapide et plus simple avec la grosse entreprise. C’est là le défi.
Comment se positionne Thalès sur ce marché-là ?
Thales, c’est 65 000 personnes, pas seulement dans le domaine de la défense. Le motto de Thales c’est « decisive technology for decisive moments » donc ce sont aussi des radars, des sonars, des systèmes de communication de guerre électronique (tout ce qui est technologie électronique), mais aussi des systèmes de sécurisation de paiement de carte de crédit, de contrôle aérien, de signalisation pour les métros ou les trains… Il y a beaucoup de facettes chez Thalès. Celle-ci a bien compris que l’avenir était dans l’informatique, les technologies de l’information et la prise en compte du digital, donc elle négocie actuellement une union avec Gemalto, qui est une entreprise de 15 000 personnes dans le domaine de la sécurité informatique. La révolution digitale, c’est une réalité. Donc d’un point de vue technologique, Thalès prend un virage très intelligent en continuant sur sa lancée vers le digital (big data, l’intelligence artificielle etc.). Bien qu’étant une grosse entreprise, Thales essaie d’avoir ses petites structures ou start-ups : nous possédons, par exemple, des structures à Rennes d’une quinzaine de personnes qui travaillent sur le digital et à qui l’on donne de l’autonomie, ce qui permet de garder du dynamisme tout en étant une grosse structure – ou bien encore une Digital Factory à Paris qui essaime à Singapour.
Face au monde industriel environnant, Thales cherche à affirmer ses positions comme toute entreprise, en étant prête à des alliances avec d’autres entreprises dans le domaine de la défense : au-delà de Gemalto, nous travaillons beaucoup avec Naval Group en France, mais nous pouvons aussi travailler avec d’autres chantiers navals.
Est-ce que Thales identifie les tendances actuelles (rapprochements, coopérations au coup par coup) comme une menace ?
La menace ne vient pas spécialement de cela, mais de la concurrence internationale qui est de plus en plus exacerbée. Elle se traduit notamment par des rapprochements ; quand ils se font au coup par coup chez nos concurrents, c’est douloureux, mais si nous, nous nous rapprochons au coup par coup de quelqu’un, nous en bénéficions au contraire. Et selon ce fonctionnement, un concurrent devient parfois un partenaire. Dans le domaine de l’industrie, il n’y a pas de loi définitive. Partir d’une loi définitive en disant : « je ne vais jamais travailler avec lui », c’est dommage parce que vous vous enfermez peut-être dans une absence de solution.
Et effectivement, ce que vous ressentez parfaitement, c’est que la concurrence est très forte dans le domaine de l’industrie de défense : les pays européens veulent en avoir plus pour leur argent ; on ne peut pas aller sur le marché américain si l’on n’est pas basé aux Etats-Unis (il faut avoir des succursales là-bas) ; les pays du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est s’arment… et toutes les industries européennes, américaines, russes, chinoises, vont leur proposer des solutions, donc il faut se différencier par de la technologie innovante qui permette de mieux répondre aux besoins des clients. D’où Gemalto et tout ce qui est intelligence artificielle, human behavioral intelligence, big data.
Pour rebondir sur cette nécessité d’adapter les projets aux besoins réels, quels sont les liens que Thales entretient avec les militaires de métier ?
On est en échange permanent avec les Armées françaises, mais aussi à l’étranger avec les armées du pays vers lequel on essaie de proposer une solution. On essaie de comprendre le besoin de l’utilisateur final, et ensuite de le traduire auprès de nos ingénieurs. C’est un processus itératif : dans les discussions que nous avons avec les marins par exemple, ils nous font part de leurs besoins, de leurs idées et nous répondons avec une solution – naturellement ceci passe par de multiples itérations. Ce qui encadre la discussion, c’est l’appel d’offres : là, légalement, la discussion est terminée jusqu’à l’attribution du marché. Donc il est important d’avoir des discussions avec les marins, non pas seulement lorsqu’on on va sur un appel d’offres, mais en permanence. De cette manière, on est capable de répondre à leurs besoins mais aussi d’anticiper des réponses.
C’est pour cela que les entreprises d’armement recrutent d’anciens militaires. Pas seulement parce que nous arrivons avec un carnet d’adresses, même si c’est vrai, mais surtout parce que nous avons la logique, le sens du langage opérationnel des militaires, et que nous sommes capables de traduire cela auprès des ingénieurs. Même si l’industrie de défense travaille pour les armées depuis toujours, ce sont deux cultures différentes avec des gens qui ne se comprennent pas nécessairement. Un exemple tout bête : quand un militaire parle d’« opérationnel », il pense « faire la guerre » ; l’industriel pensera « production de quelque chose ». On a besoin de décoder tout cela ; cela se fait en permanence. Comme le monde est très fluctuant (évolution des technologies, des doctrines militaires, des menaces et des réponses apportées), il faut se mettre au goût du jour car ce qui était vrai il y a dix ans en termes de tactique militaire n’est plus vrai maintenant, donc les outils ont besoin d’évoluer aussi. Par exemple, je pense que d’un point de vue militaire, la menace cyber ne se limite pas seulement au modèle de l’attaque Stuxnet contre les centrifugeuses iraniennes ou au fait de casser physiquement quelque chose. C’est la menace d’une perturbation du système militaire, cause de ce qu’on n’a plus confiance en lui. L’attaque cyber vient en soutien d’une attaque physique : si le militaire qui part au combat n’a pas confiance en son système, il aura moins de chances d’intercepter le missile qui se dirige vers lui. Ça, c’est une réalité.
Il faut donc durcir les systèmes d’armement fournis aux militaires, et en plus avoir des moyens de détection de ces attaques cyber pour leur garantir la possibilité de les identifier, de les couper. L’Estonie a ainsi trouvé un très bon créneau en créant un centre de l’OTAN (le cyber, c’est un vrai créneau d’expertise). Il existe aussi de vraies attaques physiques qui peuvent griller vos réseaux d’énergie, mais même sans détruire quoi que ce soit, la perte de confiance dans vos systèmes électroniques déstabilise déjà votre adversaire, donc vous marquez des points.
Et sur le marché international, comment s’adapter ?
Pour moi, il y a un marché européen sur lequel Thales est très implanté : on côtoie aussi bien les marines allemandes que britanniques (occidentales plus généralement), mais aussi australiennes. Thales, c’est français, mais c’est aussi international : il me semble que les deux tiers de nos employés sont français. Dans le monde occidental (que je définirais, pour faire simple, comme les économies libérales, les démocraties parlementaires), on retrouve les mêmes idées, les mêmes besoins, une proximité. Cependant, face à des clients qui sont en dehors de ce monde occidental, avec qui l’on n’a pas du tout la même proximité, la question, au contraire, c’est de ne pas proposer des solutions qui ne soient pas exportables. Il existe dans tous les pays un contrôle des exportations d’armement : c’est ITAR aux Etats-Unis mais on a la CIEEMG en France. C’est une procédure qui peut être longue mais qui est indispensable. Je n’ai pas envie que certains pays qui peuvent être nos adversaires demain aient la technologie adéquate pour couler un de nos bateaux. De plus, si Thales vend sans discernement toute technologie, on se met nous-mêmes en danger en tant que citoyen. Il faut être raisonnable : on ne va pas, pour faire marcher une entreprise, mettre en danger, à terme, notre propre vie, notre propre pays. Ce serait inconsidéré. On vend des solutions adaptées aux besoins, mais pas à n’importe qui et cela, même sans contrôle d’armement ; c’est du bon sens. Ainsi on n’ira jamais vendre en Corée du Nord, et on ne cherche même pas y aller.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? De votre reconversion du monde militaire vers l’industrie ?
J’identifie trois phases dans ma carrière professionnelle. Les deux premières dans la Marine, et la troisième dans l’industrie.
La première était vraiment opérationnelle : ma spécialité était la défense aérienne sur les bâtiments de combat de la Marine, mais aussi à la Royal Navy en tant qu’officier sur un destroyer. Je suis allé jusqu’au combat, et j’ai pleinement apprécié toutes les autres facettes sur toutes ces années parce que j’ai eu le sentiment de faire quelque chose d’utile, de vivre une expérience avec des équipages professionnels. Une anecdote : on entend toujours, depuis la haute Antiquité : « les jeunes générations ne valent rien » ; mais lorsque j’étais en Libye avec ma frégate[5] (où l’on a quand même tiré 350 coups de canons, et on s’est fait tirer dessus un certain nombre de fois) aucun de mes 250 marins n’a fléchi, y compris mes petits jeunes à qui je disais pour certains : « nous sommes dans une zone où il y a des mines et si l’on passe dessus, il y a un risque que le bateau ait une voie d’eau, et ceux qui sont sous la ligne de flottaison vont avoir des problèmes. J’ai fait remonter autant de monde que possible (parce que nous étions au poste de combat) mais vu que la soute à munitions est sous la ligne de flottaison, sous l’eau, j’ai besoin que vous y restiez parce que quand on va tirer au canon, il faut continuer à mettre des obus. Donc si une mine explose, vous devrez remonter en courant avant d’être submergé par l’eau. — Oui commandant, pas de problème ».
Et ils avaient 18 et 22 ans. Ils avaient compris qu’il y avait une véritable raison à notre intervention, que je prenais toutes les précautions possibles pour ne pas prendre de risque inutile, mais à un moment il faut y aller. Traduction : c’était une très agréable surprise de voir que même les plus jeunes ne sont pas à dire « j’ai peur ». Cette vie opérationnelle m’a aussi permis de toucher du doigt un nombre de réalités géopolitiques. L’important, c’est de remettre son action dans une perspective globale géopolitique, sinon on devient un robot, on est moins efficace, et on peut moins bien transmettre à ses équipes les raisons de notre action. N’importe qui a besoin de comprendre ce qu’il fait.
La deuxième facette a été vraiment géopolitique. C’était de la stratégie internationale durant laquelle je suis repassé chez les Britanniques au Royal College of Defence Studies ainsi que pour un master au Kings College London (je me méfie beaucoup des Britanniques mais je suis très anglophile et je les connais ! [rires]). Ensuite auprès du chef d’état-major de la Marine en tant que chef du Bureau Stratégie politique : donc analyse politique, stratégique… Je m’intéressais encore plus à tous les mécanismes géopolitiques, comment les comprendre et les interpréter, et comment proposer des réponses intelligentes. Et là, on se trouve toujours confronté au fait que la plus vraie, la plus brillante des analyses se heurte à la réalité de la politique intérieure nationale, et au-delà, aux limites humaines des intérêts particuliers. Ce n’est pas une raison pour baisser les bras mais il faut en être conscient. L’Union européenne est un beau projet mais tellement d’intérêts particuliers viennent le freiner… y compris individuels, d’ambitions politiques personnelles. Mais c’est à ce moment-là qu’il faut continuer, essayer de pousser la brouette. C’est ça qui a fait que je me suis orienté vers des think-tanks.
Et troisième facette, l’industrie, pour y trouver quelque chose de très concret, en plus de l’analyse. Le côté technologique est finalement très attrayant, et me permet d’aider à développer des solutions pour les marins face à leurs problèmes et leurs menaces. Je suis sur un créneau d’entraînements et de simulations ; c’est passionnant et sérieux car pour le marin, l’entraînement conditionne sa survie à la mer. Ce terrain industriel me permet de trouver un nouveau domaine d’activité, un nouveau défi, en plus de tirer tout le bénéfice de mon expérience opérationnelle en la traduisant au mieux, et toujours en discutant avec les marins… parce que dès qu’on a quitté la Marine, les menaces et les tactiques évoluent et l’on se « périme ». Et puis dans cette dernière facette, je réponds avec plaisir aux questions des étudiants.
NOTES ET REFERENCES :
[1] NDLR : parlement allemand.
[2] NDLR : négocié une option de retrait.
[3] NDLR : dans le cadre de l’opération Serval, lancée en 2013 et achevée en 2014 (depuis, il s’agit de l’opération Barkhane). Les autorités maliennes ont en effet demandé le 11 janvier 2013 l’appui de la France pour d’enrayer l’avancée des groupes terroristes vers Bamako et les repousser vers le nord du pays (source : https://www.defense.gouv.fr/operations/terminees/operation-serval-2013-2014/dossier/presentation-de-l-operation).
[4] Thyssenkrupp Marine Systems.
[5] NDLR : dans le cadre de l’opération Harmattan, en 2011.