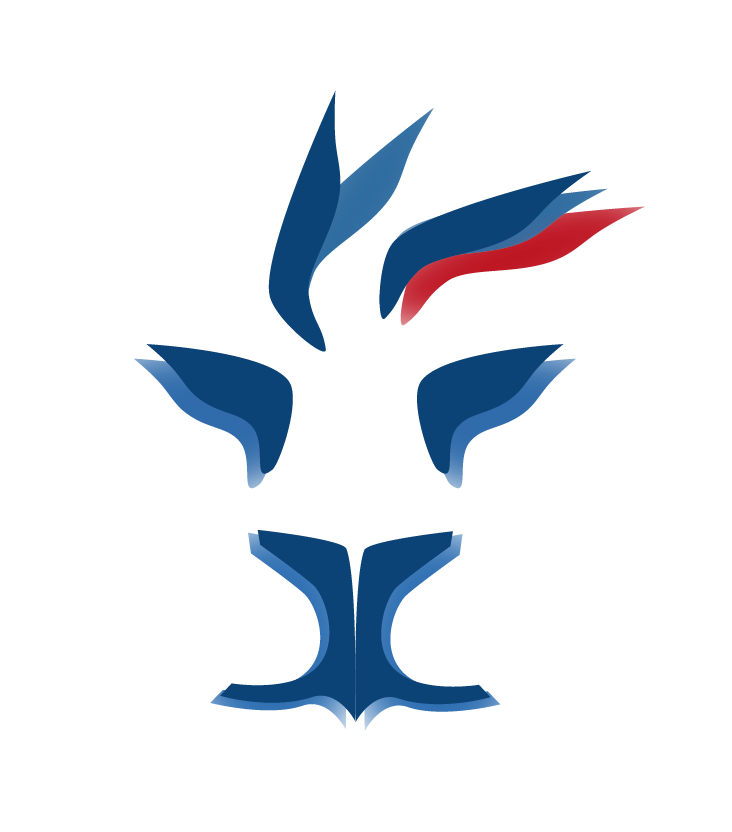Par Adrien Sémon
Le 18 juin, après une campagne électorale où les candidats furent triés sur le volet par le Conseil des Gardiens de la Révolution, le très conservateur Ebrahim Raïssi fut élu au premier tour avec 72% des suffrages pour succéder à l’actuel président Hassan Rohani[1].
Si un tel résultat acte une rigidification du système politique iranien, la période de transition précédant l’investiture début août offre de manière paradoxale une fenêtre de tir unique aux États-Unis pour revenir dans l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien quitté en 2018 par l’administration Trump. Il est indéniable que la remise en vigueur de cet accord demeure la meilleure carte pour l’Ayatollah Khamenei afin de mettre un terme aux sanctions américaines qui sapent l’économie nationale. La signature de l’accord avant l’entrée en fonction de Raïssi présente l’avantage pour le camp conservateur de faire peser le blâme sur l’administration modérée de Rohani en cas de persistance de la crise économique malgré la levée des sanctions, et dans le cas contraire, de s’en attribuer les mérites.
Loin s’en faut pour autant que le retour à l’accord de Vienne ait la même signification pour les deux parties tant les divergences apparaissent fortes depuis la reprise des négociations le 6 avril dernier[2]. Le Congrès des États-Unis demande ainsi une extension de la durée de l’accord qui, selon les termes de 2015, doit avoir cours jusqu’en 2030[3], ainsi qu’une extension des termes aux missiles iraniens et au soutien aux activités terroristes[4]. Au surplus, la toile de sanctions dressée par l’administration Trump s’avère difficile à défaire, car plusieurs entités et personnalités iraniennes se trouvent impactées non seulement au titre de leur lien avec les secteurs nucléaire ou pétrolier, mais aussi pour financement du terrorisme ou violation des droits de l’homme[5]. De ce fait, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a indiqué lors d’une audition parlementaire début juin que des centaines de sanctions seraient maintenues[6]. Dès lors, revenir dans l’accord dans les termes de 2015 sans en renforcer les contraintes ouvrirait la voie à des critiques presque unanimes de la part de la classe politique américaine contre l’administration Biden.
À ces velléités, les Iraniens rétorquent que ce sont les États-Unis qui ont rendu caduc l’accord en voulant astreindre l’Iran à en respecter les termes tout en le privant des bénéfices économiques qu’il pouvait en retirer. Le consensus politique en Iran, d’Hassan Rohani à Ebrahim Raïssi, suit en cela la voie de l’Ayatollah Khamenei qui affirmait le 21 mars dernier que son pays reviendrait à un respect complet des termes de l’accord en échange d’une levée dans les faits des sanctions qui obèrent son économie[7]. L’Iran n’acceptera de renégocier qu’à la marge et ne se pliera pas aux exigences du traité sans que les États-Unis ne consentent aux mêmes contreparties économiques qu’en 2015.
De surcroît, la stratégie de pression maximale initiée par l’administration Trump dans le but avéré de déstabiliser la République islamique n’a eu pour principal résultat que la perpétuation des conflits et des guerres au Moyen-Orient, l’Iran n’ayant aucun intérêt à restreindre ses activités ou à négocier avec les Occidentaux au sujet de l’Irak, de la Syrie et du Yémen[8]. Un tel état de fait apparaît contraire à la volonté américaine de se retirer progressivement de la région moyen-orientale pour se réorienter vers une stratégie d’endiguement de la Chine dans l’Indopacifique.
Car même étranglée, la République islamique n’a pas été asphyxiée. Et à ce jour, son principal soutien économique et allié conjoncturel demeure la Chine. Celle-ci, avec 24,8% du total des échanges en 2019-2020 fait figure de premier partenaire commercial de l’Iran[9] et reste le seul État à acheter des quantités importantes de pétrole iranien[10]. L’Iran doit également devenir un des points de passage de la nouvelle route terrestre de la Soie qui traversera l’Asie centrale[11].
Un maintien des sanctions et de la politique de pression maximale sur l’Iran ne pourrait avoir comme conséquence qu’un rapprochement accru entre Téhéran et Pékin. Cela aurait pour effet de favoriser un certain alignement politique de la première sur la seconde et de renforcer la mainmise chinoise, d’abord économique, puis potentiellement politique, sur l’Asie centrale. Un tel scénario signerait un échec, au moins relatif, de la politique d’endiguement de la Chine que souhaitent mettre en œuvre les États-Unis.
À ce titre, force est de constater que le 27 mars dernier l’Iran et la Chine ont conclu un pacte de coopération stratégique d’une durée de 25 ans qui prévoit que cette dernière investisse entre 400 et 600 milliards de dollars en infrastructures, énergies, télécommunications et transports en Iran en échange de prix attractifs sur les hydrocarbures. Est aussi envisagée la présence de militaires chinois sur le sol iranien pour superviser ces projets[12].
Dès lors, si le retrait de l’accord de Vienne en 2018 fut mis sur le compte de la politique brutale et du caractère impulsif et erratique du président Trump, l’échec à y revenir serait à coup sûr une erreur stratégique très lourde de conséquences dont la responsabilité échoirait cette fois à l’ensemble de la classe politique américaine du fait d’une trop grande intransigeance et d’un manque de clairvoyance. Entre l’endiguement de l’Iran et l’endiguement de la Chine, il faut choisir.