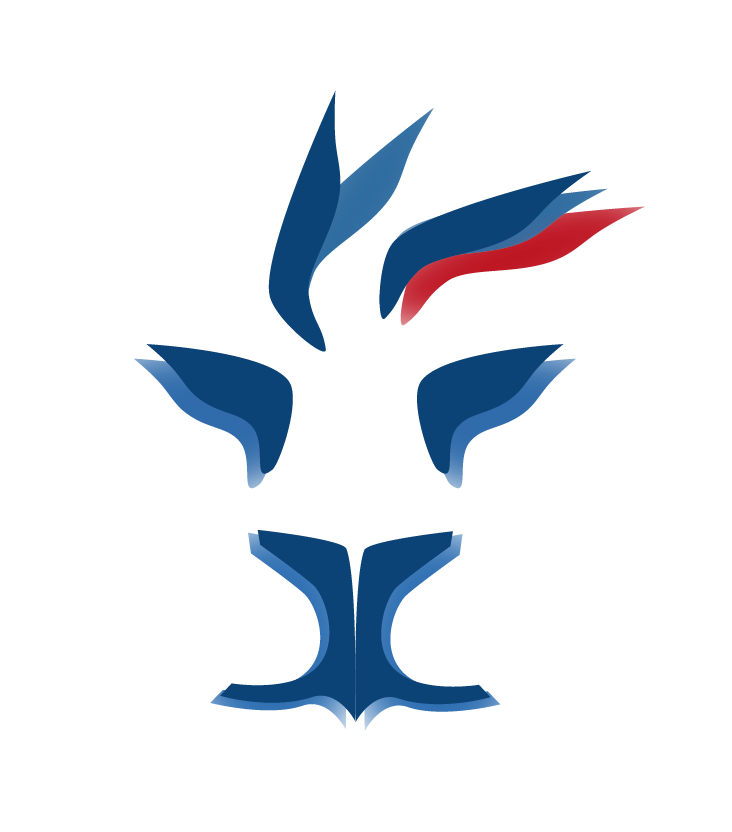Depuis la destitution du président Bozizé en 2013, la Centrafrique est enlisée dans un conflit politico-communautaire et religieux. Au coup d’État de la coalition musulmane Séléka, les chrétiens ont répondu par la formation de groupes d’auto-défense, les anti-balaka. Le pays est plongé dans une spirale de violence que la présence française et onusienne ne parvient pas à juguler. Un accord de paix, signé le 6 février 2019, prévoit un processus de désarmement, de nouvelles élections et un gouvernement « inclusif ». Il aboutit en effet à la cooptation des chefs des milices qui deviennent conseillers, préfets ou ministres. Les combats s’atténuent, mais la population est toujours en proie à la violence des groupes armés.
Après avoir présenté un bilan mitigé de l’accord de Khartoum devant le conseil de sécurité de l’ONU, le chef de la mission onusienne en Centrafrique a demandé une évolution du mandat de la MINUSCA afin qu’elle puisse « fournir le soutien technique, logistique, sécuritaire et opérationnel nécessaire à la tenue des élections dans le respect des délais constitutionnels ».
Actuellement, l’État centrafricain ne peut survivre sans les fonds internationaux qui rémunèrent les fonctionnaires et soutiennent la santé. Mais si les bailleurs cherchent à stabiliser la Centrafrique via l’application des accords de paix, l’usage des fonds internationaux est difficilement contrôlable, alors que l’Union européenne projette d’étendre son appui budgétaire à la Sécurité et la Justice.
L’intervention internationale semble du reste mue par des intérêts de realpolitik. Le pays est le théâtre des rivalités de puissance entre la France et la Russie notamment, l’une ayant affirmé son réengagement aussitôt que l’autre avait consenti à réarmer l’État centrafricain. « Dans un monde de plus en plus multipolaire, la priorité des grandes puissances n’est pas d’appliquer leurs principes mais de conserver leur influence » déplorait ainsi Thierry Vircoulon interrogé par France Culture.