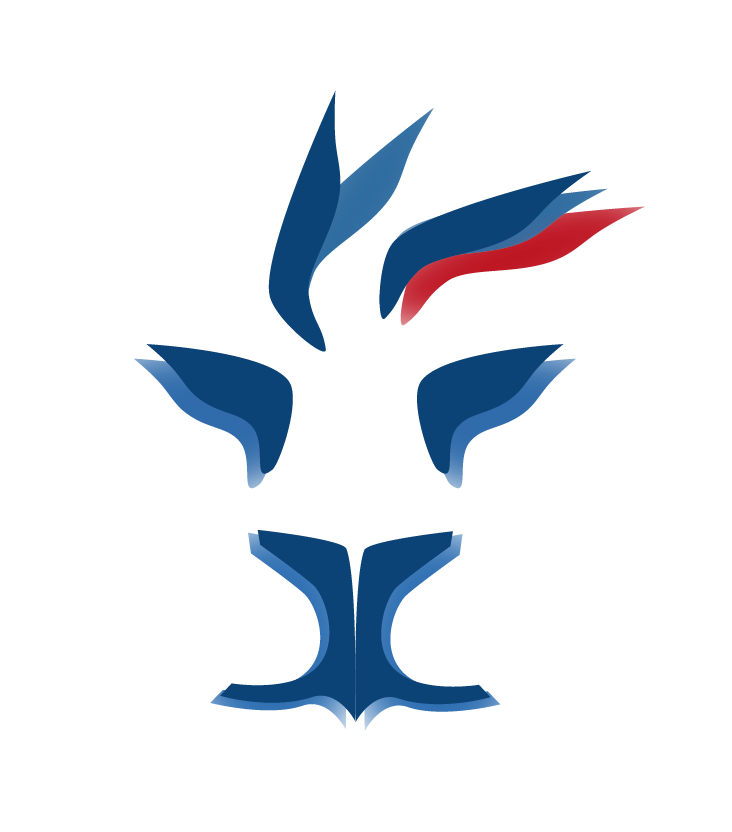Par Cyril Blanchard
Max Weber définissait l’État comme une « cette communauté humaine, qui à l’intérieur d’un territoire déterminé […] revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime »[1]. Mais la défaillance des Etats modernes fait varier les moyens de ce monopole : du para-Etat au paramilitaire, la violence légitimée se répand en une multiplicité d’offices, pour quel impact sur la définition des États ?
En effet, à défaut de pouvoir disposer de forces régulières suffisantes, un État peut avoir recours à des formations civiles ; or ces milices peuvent facilement proliférer et devenir de véritables contre-pouvoirs à même de rivaliser avec l’État en place. Peuvent apparaître, de même, des groupes non-étatiques en rivalité totale avec d’autres plus loyalistes ou même avec l’ensemble des entités présentes. Devant cette pandémie du phénomène paramilitaire, le retour à l’état de paix s’avère définitivement compromis par la multitude des acteurs.
Pour mieux saisir les tenants et les aboutissants d’un tel problème, ainsi que les réponses qui pourraient y être apportées par l’État, l’exemple libanais est des plus instructifs. En effet, le problème des milices s’est imposé rapidement aux lendemains de la guerre civile (1975-1989), lorsque l’État libanais cherche à se réaffirmer. Le meilleur outil d’unité nationale dont il semble pouvoir disposer est l’armée, considérée comme un véritable miroir de la société libanaise. Mais durant ce conflit, l’institution militaire a été émiettée et fragilisée par les aspirations divergentes de ses membres, finissant par limiter ses prérogatives à celles d’un simple arbitre archaïque (celui d’un État en faillite) et impuissant car dépassé par la puissance de certains acteurs non-étatiques. En effet, la guerre civile a été le terreau fertile de milices marquées par des solidarités particularistes (communautaires, politiques, claniques, familiales…). L’armée étant le reflet de la société par son caractère multiconfessionnel, celle-ci s’est donc morcelée et est venue alimenter le microcosme milicien.
En 1989, avec les accords de Taëf, qui mettent un terme à la période de guerre civile, l’État libanais est confronté à une armée morcelée et à une prolifération de milices non-étatiques. Quel fut le sort du système des milices dans le cadre de la reconstruction étatique libanaise ? La restructuration des forces armées libanaises a-t-elle été un succès ? Quelle est la situation actuelle des capacités militaires du pays ? De la question du processus de démantèlement à celui de la reconstruction de l’armée sous l’égide syrienne, se pose celle de son avenir, entre unité et affaiblissement capacitaire. Emerge alors la question du rapport entre celle-ci et « Résistance », et de ses conséquences sur l’état actuel de la défense libanaise.
Les accords de Taëf : retrouver la souveraineté étatique sur l’ensemble du territoire libanais.
Signés le 22 octobre 1989, les accords de Taëf visent à mettre un terme à la guerre civile libanaise en établissant un État fort et souverain sous tutelle syrienne. Pour permettre le renforcement étatique, la réorganisation des forces armées est primordiale : ainsi, l’une des mesures phares de ce plan est la dissolution des milices qui ont prospéré face à l’incapacité de l’armée libanaise à maintenir la souveraineté nationale.
Avant même que les hostilités n’éclatent le 13 avril 1975, l’armée avait déjà subi de nombreuses critiques, notamment sur la question palestinienne, fragilisant une institution déjà faible. Pendant les années 60 et 70, cette problématique est devenue l’une des causes emblématiques du panarabisme. Après la guerre des Six Jours et l’expulsion de Yasser Arafat et de ses combattants de Jordanie en raison de leurs tentatives de renverser le pouvoir, de nombreux Palestiniens ont rejoint le Liban. Cependant, par leur proximité avec Israël, les camps de réfugiés sont progressivement devenus, comme précédemment en Jordanie, les bases arrières des groupes armés palestiniens. Très vite, Israël a sommé le gouvernement libanais d’agir, sans quoi son armée interviendrait. Mais la société libanaise étant divisée sur la question palestinienne, un certain temps s’est écoulé avant que l’armée ne tente de reprendre la main, attente ponctuée par des actions israéliennes en territoire libanais. Les opérations militaires menées par les troupes libanaises contre les camps ont finalement pour seuls résultats de diviser encore plus la population et de souligner l’impossibilité désormais flagrante de désarmer les mouvements palestiniens. Les accords du Caire, signés le 3 novembre 1969, légitiment la présence de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) au sud-Liban, actant ainsi une certaine perte de souveraineté du gouvernement libanais sur son propre sol.
La composition de l’institution militaire peut en partie expliquer les difficultés d’intervention rencontrées. Tout comme la société, l’armée est alors une mosaïque confessionnelle, les postes clés sont tenus par des chrétiens la troupe étant constituée largement de musulmans. Par ailleurs, les unités sont souvent organisées sur une base confessionnelle : la solidarité particulariste prône alors sur l’appartenance nationale. L’action de l’armée, originellement d’intérêt national, peut donc facilement être confrontée aux intérêts propres d’une communauté ou d’une autre. L’inaction militaire est ainsi souvent de mise, sur le principe de la neutralité, et ne permet pas de régler certains dossiers sécuritaires sensibles. Une réponse régionale survient alors, israélienne notamment dans le cadre des mouvements armés palestiniens.
C’est ainsi que l’impuissance militaire – mais aussi politique – s’est davantage amplifiée ; les communautés finissent par prendre la décision de pourvoir elles-mêmes à leur sécurité, conduisant à une prolifération des milices et ce, dès le début des années 60. Ces milices sont organisées sur une base communautaire et poursuivent, en fonction de leur composition, des buts politiques communs ou antagonistes, mais aussi en relation avec le contexte dans lequel elles évoluent.
L’armée ne tarde pas elle aussi, à éclater et à alimenter ce système. En 1989 lors des accords de Taëf, elle est restreinte à un noyau dur loyal au gouvernement évoluant parmi de nombreuses milices, armées et entraînées, dont certains membres sont issus de ses propres rangs. De fait, la dissolution de ces groupes doit s’effectuer au profit de l’armée pour que l’État puisse à nouveau s’imposer. Cependant, d’obédiences confessionnelles mais aussi politiques différentes, toutes ne sont pas partisanes de cette solution à l’amiable. Plusieurs d’entre-elles jugent le gouvernement – et donc ses décisions – illégitime, notamment en raison de son parlement non renouvelé depuis les dernières élections législatives de 1972. L’armée elle-même se retrouve instrumentalisée entre deux gouvernements, l’un civil, l’autre militaire, institués entre 1988 et 1989 après le mandat d’Amine Gemayel[2]. Les affrontements avec les milices s’amplifient et atteignent leur paroxysme avec l’intervention syrienne qui met un terme au gouvernement militaire du général Michel Aoun. Avec cette intervention, le pouvoir libanais, soutenu par la Syrie, dont la présence est justifiée par les accords de Taëf, peut dès à présent se consolider, notamment en réformant ses moyens sécuritaires et militaires.
Une souveraineté en demi-teinte : reconstruire une armée sous l’égide syrienne
La reconstruction de l’appareil sécuritaire est actée dès l’entérinement des accords de Taëf par le Parlement libanais en août 1990. Cependant, en raison de la tutelle syrienne qui souhaite conserver son ascendant régional, cette reconstitution n’est pas synonyme de renforcement : alors que les armes des milices dissoutes doivent à l’origine être remises à l’armée libanaise, de nombreuses groupes armés préfèrent effectuer leur désarmement auprès des forces syriennes dont elles s’estiment plus proches[3]. De même, le régime de Damas participe à l’entraînement des officiers libanais – surtout idéologique, car les doctrines des deux pays sont opposées entre celle occidentale des Libanais et celle soviétique des Syriens – mais ne lui fournit pas de matériel. L’armée libanaise se voit privée de nombreux équipements qui lui font défaut et limitent sa capacité d’action. Des miliciens parviennent aussi à conserver leurs armes en les dissimulant, tandis que d’autres refusent la dissolution de leurs unités. Le processus de désarmement se solde ainsi par un échec.
Quant au sort des membres de tels groupes armés, sur les dizaines de milliers de combattants, 6 000 ont rejoint les appareils sécuritaire et militaire libanais. Bien qu’une sélection subsiste, nombre de miliciens ont simplement refusé cette incorporation par méfiance envers un gouvernement jugé illégitime, mais également par lassitude de porter des armes et de se soumettre à une hiérarchie. Sur ces 6 000 combattants, 5 000 sont musulmans[4], soulignant la défiance des chrétiens envers les nouvelles institutions[5]. En effet, les milices chrétiennes sortent affaiblies des dernières années de la guerre civile marquées par des luttes inter- mais aussi intracommunautaires. De plus, leurs membres sont dissuadés de s’engager dans une carrière dans la fonction publique, car la tutelle syrienne cherche à les isoler, afin de favoriser ses anciens alliés majoritairement musulmans. Néanmoins, le contrôle syrien n’empêche pas l’armée de prendre des mesures pour éviter de nouvelles défections en cas de crise. Les unités sont mélangées afin de ne plus être homogènes sur le plan confessionnel. Les miliciens enrôlés sont postés dans leurs villes natales ce qui permet de renforcer les liens entre la population et l’armée. Cependant, ce phénomène de rapprochement ne parvient pas à éliminer les solidarités particularistes et le clientélisme au sein même de l’administration publique. En intégrant l’administration ou l’armée, les miliciens mettent de côté leur ancienne appartenance mais ne l’oublient pas. Ce passage à la vie civile aurait dû mettre un terme à la culture milicienne, mais cela provoque l’effet inverse : celle-ci perdure. Lorsque les entités combattantes ont mué en partis politiques, les anciennes appartenances et liens forgés lors de la guerre civile ont refait surface.
Devant cet échec, un nouvel élément fédérateur est recherché. L’instauration du service militaire est un premier pas vers cette union souhaitée. Les conscrits évoluent ensemble quelle que soit leur confession et ne peuvent pratiquer leur religion qu’à l’écart et discrètement. Tout est fait pour amoindrir les différences et tenter de créer un sentiment d’appartenance nationale. Par ailleurs, la désignation d’un ennemi commun pour unifier la population est un autre procédé employé[6] : il s’agit de libérer le sud du pays, occupé depuis 1982 par Israël et ses alliés. Ce processus légitime le maintien d’une des milices qui aurait dû être dissoute conformément aux accords de Taëf : le Hezbollah. Ce groupe devient l’incarnation de la résistance contre Israël. Son refus de se soumettre au désarmement est toléré aussi bien par la Syrie que par une partie de l’armée libanaise. Pour la Syrie, d’une part, la présence du groupe participe au non renforcement de l’armée libanaise, en constituant un contre-pouvoir ; d’autre part, l’organisation est en première ligne contre Israël. Certains militaires libanais souhaitent aussi l’utiliser ou la soutenir dans ce combat comme le commandant en chef Emile Lahoud[7]. Sa dissolution n’est donc pas une priorité d’autant que le Hezbollah évolue dans les territoires chiites pauvres propices à l’apparition de ce genre de groupes. Il remplit ainsi une des missions que l’armée ne peut effectuer en raison de la disproportion des forces en présence et de la volonté affichée de rester neutre. L’armée sert alors avant tout à la défense du territoire, au maintien de l’ordre aux côtés des forces de l’Intérieur et aux missions humanitaires. Ainsi apparaît la bipolarité du système de défense libanais : Hezbollah et armée nationale. La logique des milices a donc survécu, la dissolution au profit de l’armée a échoué.
Le rapport entre l’armée et le Hezbollah : l’armée, le peuple et la Résistance
L’armée syrienne quitte le pays en 2005, levant sa tutelle. Le système sécuritaire libanais semble pouvoir redevenir indépendant bien que des craintes subsistent quant à la présence clandestine d’agents du renseignement syrien. L’État semble enfin pouvoir devenir seul détenteur de la violence légitime. Néanmoins, la présence du Hezbollah est difficilement neutralisable depuis la politisation du mouvement dans les années 90. Cette décennie a en effet été marquée par la rivalité croissante entre l’armée et les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) libanaises, rivalité entretenue par la Syrie mais aussi par le clientélisme, ce qui conduit à une limitation de leurs capacités d’action respectives. Des affrontements entre les services gouvernementaux et des milices éclatent régulièrement, focalisant l’attention des forces armées sur la scène intérieure. Le Hezbollah profite donc de cette situation pour combler le vide sécuritaire laissé contre Israël renforçant de fait son rôle de résistance.
Un an après le départ syrien, en 2006, les tensions sont telles entre l’État hébreux et le Hezbollah que Tsahal envahit le sud du Liban après qu’une infiltration de la milice chiite lui ait coûté plusieurs pertes et deux prisonniers. La guerre de 2006 marque la consécration du Hezbollah par la résistance qu’il oppose aux troupes israéliennes. Néanmoins, avec le départ syrien, coïncide aussi la volonté de l’armée libanaise de s’affirmer en tant que seule force légitime, mais cette réaffirmation ne peut dissimuler les failles mêmes de l’institution dépendante du soutien occidental sur fond de tensions régionales grandissantes. Ainsi, la présence de la FINUL[8] souligne les inconstances de l’armée libanaise qui la considère comme une garantie de l’intégrité de la frontière sud du pays. Cette décharge de responsabilité est consentie, tandis que l’éclatement de l’appareil sécuritaire a été et est toujours subi, d’abord par l’ancienne tutelle syrienne, puis par la consécration du Hezbollah[9]. Les mesures prises pour créer un sentiment national à même de garantir l’unité et, de ce fait, l’indépendance du Liban dans le domaine sécuritaire, s’avèrent encore insuffisantes voire contre-productives. C’est ainsi que le service militaire est suspendu en 2007 en raison des tractations politiques dont il pouvait faire l’objet mais aussi en raison de son coût et du manque d’entrain de la population.
L’héritage de la guerre civile demeure, le système milicien n’a pas disparu ; on assiste même à un renforcement des milices religieuses. Dès 2004, une vague d’attentats a poussé les individus à privilégier de nouveau leur appartenance confessionnelle. Des sociétés de sécurité privée ont alors fleuri avec l’accord du ministère de l’Intérieur géré par le clan Hariri, favorable aux sunnites. Ces sociétés emploient près de 10 000 personnes, majoritairement de cette confession[10]. Ce cadre légal constitue alors un véritable pool de recrues et d’équipements individuels, favorable à l’organisation de milices. En effet, ce réarmement plus ou moins discret semble global et suscite une inquiétude grandissante depuis la guerre de 2006. Le rôle du Hezbollah et l’impuissance relative de l’armée libanaise ont fait resurgir les craintes des différentes communautés. C’est ainsi que les affrontements en 2008, déclenchés après la fermeture du réseau de télécommunication du Hezbollah et le limogeage du chef de la sécurité de l’aéroport Rafic Hariri, ont pris une tournure confessionnelle. En effet, les combats opposèrent dans les quartiers de Beyrouth-Ouest, majoritairement musulmans, les partisans sunnites du Courant du Futur, membres de “l’Alliance du 14 mars” (fondée lors de la Révolution du Cèdre[11] en 2005) proche du gouvernement, et le Hezbollah, l’organisation chiite[12]. L’armée ne prit pas part à ce conflit pour éviter un embrasement susceptible de renforcer les tensions communautaires.
Afin de pallier à l’inaction de l’armée et au clientélisme des FSI, les communautés refont de leurs intérêts propres une priorité, nécessitant donc de s’organiser et de s’équiper. Parmi les résolutions de l’ONU cherchant à mettre un terme au conflit de 2006 en instaurant une trêve, celle dite 1701 concernant notamment le trafic d’armes, est régulièrement violée, en attestent les cargaisons d’équipements interceptées par les douanes ou l’armée. La FINUL ne peut y participer directement mais peut avertir l’armée en cas de soupçons sur des cargaisons ; cette dernière prendra les mesures qu’elle jugera nécessaires sans forcément en rendre compte à la force onusienne. Dans certains cas, les armes transitent donc même après avoir été interceptées. L’ONU multiplie alors les appels à la dissolution des groupes armés afin que l’État libanais recouvre sa pleine souveraineté. Néanmoins, la principale crainte étant le sentiment de menace persistante dû aux faiblesses de l’institution militaire, l’armée tente de mener sa propre campagne pour redorer son blason, créer des vocations et enclencher sa remontée en puissance ; cela permettrait de renouer le lien entre l’État et le peuple afin que ce dernier accepte de remettre sa sécurité essentiellement entre les mains du premier. De fait, le problème des milices ne se poserait plus, ou tout du moins, ces dernières perdraient en influence et viendraient se ranger dans le giron étatique.
La situation après la guerre de 2006
Les accords mettant fin à la guerre de 2006 constituent un premier pas vers un processus de paix en déployant 15 000 soldats libanais à la frontière sud pour limiter l’influence du Hezbollah[13]. Néanmoins, le Hezbollah ayant des membres au sein du gouvernement, l’armée ne peut totalement s’y substituer et doit composer avec ces derniers. La guerre de 2006 a toutefois suscité un élan d’aides internationales pour les forces libanaises – malgré un engagement restreint –, de nombreux pays lui fournissent équipements et fonds pour moderniser ses forces et entamer une montée en puissance.
Au niveau opérationnel, les premières actions d’importance que l’armée libanaise mène après 2006 concernent des groupes armés se servant des camps de réfugiés comme base arrière à l’image de Fatah-al-Islam, mouvement salafiste djihadiste. Cependant, c’est la guerre civile syrienne qui constitue le contexte de nombreuses opérations de l’armée libanaise. En effet, les rebelles syriens profitent de la porosité des frontières pour se servir de la vallée de la Békaa comme d’une base arrière. Ces infiltrations entraînent forcément une réaction armée du Liban, d’autant que le Hezbollah participe déjà aux affrontements syriens. L’offensive “Aube du Jouroud” lancée par l’armée en août 2017, contre des groupes djihadistes, peut être considérée comme la première d’envergure depuis les accords de Taëf : plusieurs milliers de soldats sont déployés pour neutraliser les positions de Daech à la frontière syro-libanaise.
Le soutien américain – 1,7 milliard de dollars entre 2007 et 2018[14] – et celui d’autres pays ont permis un certain renforcement de l’armée libanaise notamment pour faire obstacle au Hezbollah. À première vue, la situation semble donc se renverser, mais le Hezbollah monte lui aussi en puissance, à l’extérieur des frontières, notamment sur le sol syrien, alors que l’armée reste confinée dans les limites de l’État libanais. Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, qualifie même l’armée de « police en uniforme »[15]. En effet, l’intégration des miliciens dans les rangs de l’institution militaire et dans ceux de l’administration a perpétué un système de copinage et de cooptation qui désunit plus qu’il ne cimente et bride les capacités de l’ensemble. Comparativement, le Hezbollah se montre plus soudé que l’armée et semble plus apte à se projeter, en atteste son soutien au régime de Damas durant la guerre civile syrienne. De surcroît, sa reconnaissance en tant que « Résistance » lui confère un statut dont les autres milices ne jouissaient pas. Son intégration ne semble actuellement plus possible, hormis sur initiative du groupe lui-même, ce qui semble peu probable. Le pouvoir libanais doit donc composer avec une milice puissante mais son acceptation publique pourrait lui permettre de la considérer comme partie intégrante du jeu politique libanais. Ainsi, la dissolution du Hezbollah ne pourrait être acquise en définitive qu’une fois sa raison d’être atteinte ou rendue caduque. Cela passerait donc par le règlement des tensions au Proche-Orient, notamment entre Israël et l’autorité palestinienne, ou par son intégration aux forces armées libanaises.
Depuis les accords de Taëf, l’armée libanaise ne détient donc pas le monopole de la violence armée, elle doit la partager avec d’autres acteurs avec lesquels elle agit positivement ou négativement. Les faiblesses politiques inhérentes au modèle libanais font que la plupart des maux actuels du pays trouvent leur racine avant même la guerre civile. Celle-ci n’a fait que les exposer au grand jour. Le système milicien a été une réponse aux failles libanaises, la population se retranchant vers des valeurs sûres à ses yeux, comme les solidarités particularistes. La montée en puissance des milices par rapport à une armée restreinte dans ses mouvements a été la principale difficulté à l’unification politique du Liban. Cette faiblesse alimente ainsi la tentation d’un État fort, proche du despotisme. Ce sont les manques d’action et de décision qui ont abouti au bipolarisme sécuritaire au Liban. L’intégration des milices, en plus d’avoir échoué, a renforcé au niveau étatique le clientélisme et maintenu le rôle des solidarités particularistes. Dès que le rapport de force s’est inversé au profit des milices leur intégration est devenue problématique. L’État libanais ne dispose pas des outils nécessaires à son propre renforcement : la tutelle syrienne a contribué à cet affaiblissement, avant que le Hezbollah ne profite de ces défaillances pour émerger. En l’absence d’un consensus populaire et d’un pouvoir fort doté de capacités de défense et de sécurité résilientes, la dissolution des groupes armés non-étatiques au profit du monopole wébérien semble être repoussée à des horizons plus lointains, au détriment du Liban.
[1] Max Weber, Le Savant et le Politique, 1919.
[2] MOUSSA N., « L’armée libanaise : une exception dans le paysage militaire arabe », Les Champs de Mars, vol. 23, no. 1, 2012, pp. 57-77.
[en ligne] : https://www.cairn.info/revue-les-champs-de-mars-ldm-2012-1-page-57.htm#pa21
[3] PICARD E., The demobilization of the Lebanese Militias, Centre for Lebanese Studies, Oxford, 49 pages, p.10 et 15.
[4] Idem.
[5] MOUSSA N., « L’armée libanaise : une exception dans le paysage militaire arabe », op. cit..
[6] BOLTANSKI C., “Au Liban, les anciens miliciens se reconvertissent dans l’armée”, Libération, 14 Avril 1995.
[en ligne] : https://www.liberation.fr/planete/1995/04/14/au-liban-les-anciens-miliciens-se-reconvertissent-dans-l-armee_130285
[7] MOUSSA N., « L’armée libanaise : une exception dans le paysage militaire arabe », op. cit.
[8] Force intérimaire des Nations unies au Liban.
[9] ASMAR P., « La formule « l’armée, le peuple et la Résistance », TIPA, Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage, 2017,
[en ligne] https://journals.openedition.org/tipa/1947
[10] MALBRUNOT G., “Les milices libanaises commencent à réarmer”, Le Figaro, 19 Avril 2007,
[en ligne] : http://www.lefigaro.fr/international/2007/04/19/01003-20070419ARTWWW90394-les_milices_libanaises_commencent_a_rearmer.php.
[11] Après la mort du premier ministre Rafiq Hariri le 14 février 2005, une partie du peuple libanais manifeste pour la vérité sur cet assassinat et le départ syrien, tandis qu’une autre partie soutient la Syrie. Des coalitions politiques se forment alors, celle de “l’Alliance du 8 mars” pour les partisans de la Syrie et celle du “14 mars” pour leurs opposants en quête de vérité.
[12] MOUSSA N., « L’armée libanaise : une exception dans le paysage militaire arabe », op. cit.
[13] Idem.
[14] https://www.france24.com/en/20180829-lebanon-russia-uses-softer-touch-win-influence
[15] GEISSER V. « L’armée libanaise : symbole d’une nation réconciliée ? », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypothèses.org), 15 janvier 2013. [En ligne] http://ifpo.hypotheses.org/4687