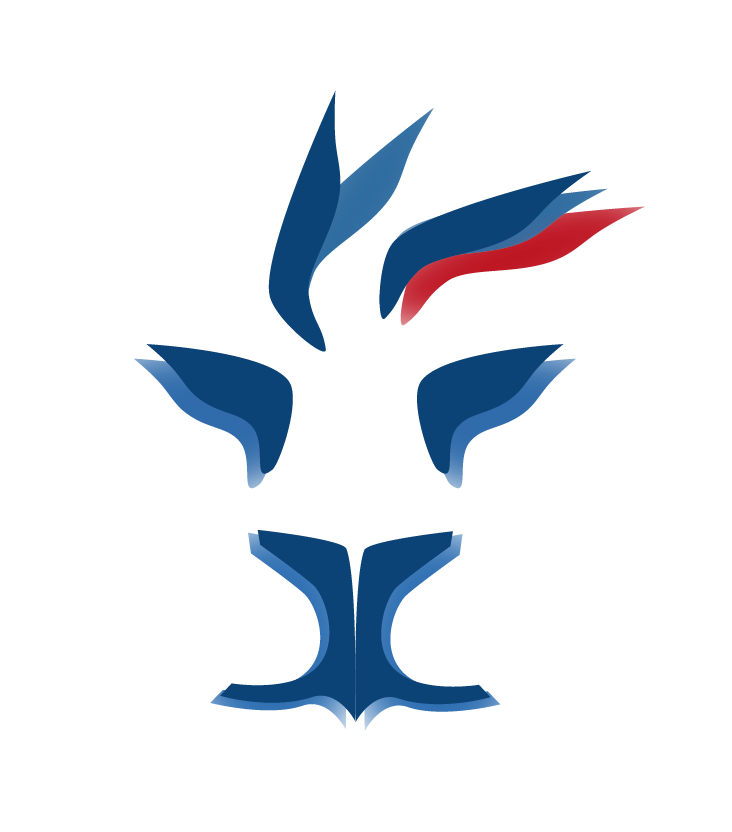Propos recueillis par Sabil Zeroual et François Gaüzère-Mazauric
Olivier Forcade est professeur à l’université Paris-Sorbonne. Internationaliste reconnu et spécialiste de l’histoire du renseignement, il a notamment écrit La République secrète. Les services spéciaux militaires en France de 1918 à 1939 (Paris, NME, 2008), mais aussi Secrets d’Etat, Pouvoirs et renseignement dans le monde contemporain, co-écrit avec Sébastien-Yves Laurent (Paris, Armand Colin, 2005), avec Jean-Pierre Bat et Sylvain Mary, Jacques Foccart : archives ouvertes (1958-1974), PUPS, 2017. Nous tenons à le remercier chaleureusement de l’entretien passionnant, publié en deux volets, qu’il a bien voulu nous accorder.
Cette deuxième partie de l’entretien s’articule autour des enjeux méthodologiques liés à l’étude scientifique du renseignement : retraçant la genèse disciplinaire et académique de ce champ d’investigation, du Corpus Chrsiti College de Cambrige des années 1980 aux séminaires organisés en France par l’Amiral Lacoste dans les années 2000, le professeur Forcade invite à un approfondissement épistémologique de l’objet par le croisement des approches spécifiques aux différentes sciences sociales.
B. D. : Le diplomate britannique Alexander Cadogan a dit du renseignement qu’il était la dimension oubliée de l’histoire des relations internationales (« the missing dimension of most diplomatic history »). Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Et quelle place faut-il accorder au renseignement dans l’explication des événements internationaux ?
Olivier Forcade : Je crois d’abord que la question du renseignement n’est pas abordée de la même manière selon le pays et les universités dans lesquels on travaille. Autrement dit, il y a des historiographies nationales qui se sont saisies plus ou moins hâtivement, de manière plus ou moins ancienne, de l’étude du renseignement. Tout a commencé dans les universités britanniques ; l’histoire du renseignement y a d’abord été nourrie d’une approche d’histoire diplomatique, puis de l’histoire des relations internationales, et enfin de l’histoire militaire.
La première historiographie du renseignement a donc d’abord été saisie à travers cette triple approche ; dans un deuxième temps, l’histoire du renseignement s’est enrichie d’une approche politique et économique, dans des universités étudiant le droit, ou encore la sociologie des relations internationales. Il faut ici évoquer en particulier le cas du Corpus Christi College de Cambridge. C’est autour de Christopher Andrew, que les études de renseignement s’y sont constituées dans les années 1980 ; Christopher Andrew avait commencé à travailler à partir d’une approche des relations internationales et diplomatiques à la fin des années 1960 ; il a à ce titre rencontré Pierre Renouvin. Dans les années 1970, ces études commencent véritablement à constituer un chaînon de l’histoire générale des relations internationales. On peut aussi citer l’université d’Aberystwith au Pays de Galles, qui a accueilli en 1920 la première chaire d’histoire des relations internationales, créée grâce aux dons d’un généreux mécène. C’est donc dans la discipline des relations internationales qu’il faut placer l’histoire du renseignement.
C’est dans l’entre deux guerres que les premières chaires de relations internationales s’intéressent au renseignement, notamment à travers l’étude des policy makers par exemple. Il s’agit au début de précurseurs qui travaillent souvent seuls, en dehors du cadre institutionnel. Il faut donc attendre les années 1970 et 1980 pour les études de renseignement gagnent leur autonomie, dans différentes universités britanniques, notamment à Glasgow, où Peter Jackson installe actuellement l’histoire du renseignement. Le cas anglais est toutefois une singularité dans un paysage européen qui a connu tardivement le développement des études de renseignement – quelle que soit la discipline par laquelle on se saisissait de ces questions.
C’est deuxièmement par le biais des études d’histoire militaire que la question a été saisie dans les années 1980 et 1990, notamment dans les universités scandinaves de défense, financées par les ministères de la défense qui vont accorder une attention particulière aux études de renseignement à la fin de la guerre froide.
A partir de ces pôles, il s’est agi d’acclimater l’objet aux différentes approches qu’on pouvait concevoir. L’histoire des relations internationales a d’abord été privilégiée, en ce qu’elle permettait précisément de croiser les disciplines : l’économie, la sociologie, le droit ou l’histoire. La notion de renseignement étant elle-même très plastique, elle peut être abordée par plusieurs disciplines. La rencontre de la plasticité des relations internationales et de la plasticité de l’étude du renseignement a produit la richesse de l’objet.
F. G-M : Quelle place, en définitive, faut-il accorder au renseignement dans l’explication des événements internationaux ?
Olivier Forcade : Je vais répondre de manière théorique et pratique. La première tentation est d’évacuer toute théorie du renseignement dans les relations internationales comme non probante, parce que renvoyant à des représentations, à des faits culturels, à l’histoire de cultures administratives ou de corporations, qui ne donnerait pas la clé de la politique internationale. C’est là la première approche.
L’autre approche contradictoire, dont il faut également se défier, consiste à croire ou à vouloir croire, dans une approche complotiste, que tous les événements internationaux seraient mus par la force visible ou invisible du renseignement. Cette approche est tout aussi fausse que la première : ce n’est pas parce qu’il y a du renseignement qu’il constitue une clé première voire nécessaire à la compréhension des phénomènes généraux. Il faut éviter toute théorisation hâtive qui écarterait ou incorporerait nécessairement le renseignement à toute explication de la politique internationale. Il faut le considérer comme une variable explicative parmi d’autres.
B.D. Il semble que le champ français d’étude sur le renseignement ait pour discipline maîtresse l’histoire. Quelle est donc la valeur ajoutée de l’histoire pour aborder les questions de renseignement ?
Comme vous vous adressez à un historien, il va vous répondre favorablement. Mais si vous posiez la question à un juriste ou à un politiste, il vous répondrait que c’est d’abord par leur discipline que l’on parle de manière convaincante du sujet. Par conséquent l’acculturation des questions de renseignement dans le débat public se fait aussi par la production académique de savoirs, de réflexions, de notions, auxquelles concourent évidemment de manière forte le droit, la science politique et la science administrative, qui étudient les pratiques, les concepts, les institutions, les cadres juridiques – en somme les logiques d’évolution de ces institutions. Je dirais donc que l’historien doit travailler avec le droit, la science politique, bien évidemment ; on peut aussi analyser les cultures de renseignement à travers des productions qu’on dira « sensibles », portant sur les imaginaires, les représentations, mais aussi sur leurs vecteurs, en particulier la littérature et le cinéma. Après tout, les études cinématographiques auraient beaucoup à apporter au sujet. Parlant de littérature, il faudrait aller regarder du côté des grands romanciers ; il y a d’ailleurs une thèse à faire sur le renseignement chez Gérard de Villiers, ou chez John le Carré (NDLR : plusieurs ouvrages consacrés au renseignement chez John le Carré existent en langue anglaise, notamment Aronoff. M, The Spy Novels of John Le Carré, Balancing Ethics and Politics, Palgrave Macmillan US, 1999). Alors oui, pour vous répondre, je pense qu’il faut enrichir l’étude épistémologique du renseignement par une approche de philosophie politique, je suis tout a fait d’accord avec vous.
B. D. Pourriez-vous retracer les grandes dates, ainsi que les gestes théoriques et scientifiques qui ont compté dans la constitution d’un champ français d’étude sur le renseignement ? Pourriez-vous en particulier remettre en perspective le rôle clé qu’a joué l’Amiral Lacoste dans l’inauguration de ce vaste chantier intellectuel ?
Je vais vous redonner en quelques mots les grandes dates. Pierre Lacoste, né en 1924, a été chef du cabinet militaire du Premier ministre Raymond Barre de 1978 à 1980, commandant de l’Escadre de la Méditerranée en octobre 1978 ; il fut ensuite nommé directeur de la DGSE de 1982, avant d’être limogé en 1985 lors de l’affaire du Rainbow Warrior, refusant de démissionner pour que le pouvoir politique assume sa pleine responsabilité. Il a joué un rôle clef dans le développement des études sur les relations internationales, et en particulier sur les études de défense et de sécurité, lorsqu’il présidait la Fondation des études de défense nationale (FEDN) de 1986 à 1989. C’est à la fin des années 1980 et au début des années 1990 qu’il a cherché à insuffler l’histoire et l’étude du renseignement dans le milieu universitaire français. Il va créer pour cela un séminaire organisé à l’Ecole Polytechnique qui est un lieu de rencontre intéressant. Ce projet débouche en 1998 sur la publication de son maître-livre Le renseignement à la française (NDLR : Paris, Economica, 1999), qui reprend les conclusions des trois années de séminaire.
Au fond, son action va jouer un rôle de cristallisation en provoquant la rencontre d’abord d’historiens, puis de juristes, de sociologues, d’économistes, de militaires, de civils, de policiers, de juges etc. qui, parlant du même objet, mais avec des approches et des finalités distinctes, vont s’attacher à donner corps à la question. Au basculement des années 1990-2000, commencent à apparaître quelques travaux à Saint-Cyr Coëtquidan, dans le cadre du séminaire que j’avais contribué à lancer pour former les jeunes saint-cyriens à ces questions-là. L’un des premiers colloques sur l’exploitation du renseignement a eu lieu à Coëtquidan en 1998 ; il a été publié en 2001 (NDLR : Georges-Henri Soutou, Jacques Frémeaux, Olivier Forcade (dir.), L’Exploitation du renseignement, Paris, Economica, 2001).
On peut donc dire que l’Amiral Lacoste a joué un rôle clef d’initiateur, de catalyseur, en favorisant les rencontres, dans le meilleur sens du terme. Pour ce qui est des « grandes dates », l’expression me semble trop forte, et il est encore trop tôt pour dire s’il y a eu des tournants. Je peux quand même dire une chose sur cette question : dans beaucoup de publications et d’interviews, il est de bon ton de toujours pointer le retard des études françaises sur le renseignement. Il est temps de faire un inventaire précis, objectif et critique de la question, en regardant les travaux et les collections existantes, ainsi que les thèses qui ont été écrites sur le sujet dans le cadre d’habilitations à diriger des recherches. En ce qui me concerne (NDLR : dans le cadre de l’Université Paris-Sorbonne) j’ai pu encadrer ou superviser en dix années de nombreux travaux, dont celui de Françoise Thom en 2011, qui a fait son habilitation sur la figure de Béria, le « Janus du Kremlin », pour reprendre son titre. Il y a eu ensuite l’habilitation de Guillaume Bourgeois en 2013 sur l’Orchestre rouge (NDLR : Guillaume Bourgeois, Le secret dans le monde communiste, Université de Paris IV-Sorbonne, 5 volumes, dont un volume de recherche, La Légende de l’Orchestre rouge, 6 décembre 2013), qui aborde la question des réseaux du Kominterm, habilitation concomitante de celle de François David, aujourd’hui maître de conférence à Lyon III, sur la naissance de la CIA et la cristallisation de la communauté américaine du renseignement (NDLR : François David, Diplomatie, sécurité et défense. Pouvoir, puissance et influence en relations internationales au prisme de la France et des Etats-Unis, Université de Paris IV-Sorbonne, 3 volumes, dont un volume de recherche inédite, L’Aigle et le Vautour. L’institutionnalisation de la CIA 1945-1961, 680 p., 16 novembre 2013). On peut aussi mentionner l’habilitation de Jean-François Klein, actuellement professeur au Havre, qui a travaillé sur les origines militaires du renseignement colonial, et son éthique, en étudiant pour cela la méthode dite de la « tâche d’huile » décrite par Gallieni et Pennequin (NDLR : Mémoire inédit, Pennequin : une éthique coloniale française ? Penser la pacification, dépasser la colonisation (1849-1916)), enfin celle d’Emmanuel Droit en 2016, dont nous étions garant avec Hélène Miard-Delacroix, sur les coopérations secrètes de la Stasi dans le bloc de l’Est de 1955 à 1989 (à paraître chez Gallimard prochainement). Sébastien Laurent a également conduit son premier doctorant à soutenir en 2017, comme d’autres font soutenir des travaux sur les questions juridiques nationales et les aspects internationaux du renseignement à Paris II (Olivier Gohin, Emmanuel Decaux récemment…). Comme vous le voyez les thèses, les ouvrages, les articles, les livres et les collections en la matière ne manquent pas ; et c’est grâce à l’ensemble de ces travaux que peu à peu la discipline a pu prendre corps.
B.D. L’étude historique des services de renseignement français fait-elle ressortir un art français du renseignement, ou en tout cas une certaine approche particulière à ce pays ? En somme, peut-on parler d’un « renseignement à la française » ?
Bien sûr. L’histoire de l’Etat écrit l’histoire du renseignement. Par conséquent les spécificités de l’Etat en France dessinent la singularité du renseignement français.
S.Z : L’historiographie du renseignement ne s’est-elle pas par ailleurs heurtée à la difficile question de l’accès aux archives ?
Dans le cas de l’Europe continentale, il faut en effet attendre la fin des années 1990, voire le début des années 2000 pour que véritablement des spécialistes travaillant sur des archives constituent ces études en domaine propre. Pour citer plusieurs pays, en Espagne, c’est au début des années 2000 que ces études se sont développées autour de l’université Rey Carlos III ; en Allemagne, cela se fait autour de l’université de la défense de la Bundeswehr, à Postdam, et dans certaines universités du Sud de l’Allemagne comme l’université de Marburg, où Wolfgang Krieger enseigne ; le cas de Wolfgang Krieger est emblématique : c’est un spécialiste des relations internationales qui s’intéresse au renseignement dans un second temps.
Il ne s’agissait donc pas tant, pour reprendre les termes de votre première question, d’une dimension oubliée de l’histoire que d’une dimension impossible ; les archives semblaient ne pas devoir exister. Il faut attendre le livre d’Alain Dewerpe – NDLR : Espion, une anthropologie historique du secret d’Etat contemporain, Gallimard, 1994 – pour que l’histoire se saisisse du secret de l’Etat. On a pu, dès les années 1990, après le livre de Sophie Coeuré à partir de l’odyssée des archives de Moscou – NDLR : La mémoire spoliée : les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique de 1940 à nos jours, Payot, 2007 – se saisir de l’objet, et le constituer à travers l’étude d’archives. Par conséquent, ce qui était une histoire non pas oubliée mais impossible, devient une histoire possible, sur un objet encore improbable, qui va au fur et à mesure révéler tout son intérêt.
B.D : Georges-Henri Soutou a par exemple pour méthode d’aller systématiquement dans chaque pays concerné par le sujet qu’il traite pour dépouiller les fonds d’archives déclassifiés, ce qui lui permet de croiser les différentes sources…
C’est comme cela qu’il faut faire ! Il faut une approche par la documentation des différents pays, pour peu que cette documentation soit accessible. En réalité, vous avez très peu de pays qui ont constitué et qui ouvrent leurs archives sur le renseignement. Il ne faut pas s’y tromper. On peut faire cela sur des périodes contemporaines. Les services de renseignement n’ont pas vocation à ouvrir leurs archives et à les mettre sur la place publique, à moins qu’ils ne confient cette tâche à des commissions d’historiens, comme en Allemagne. Vous avez un exemple avec la Commission pour l’histoire du renseignement, présidée par Wolfgang Krieger. Cela a été fait au Royaume-Uni, pour la seule Seconde guerre mondiale, sous la direction de Sir Harry Hinsley, mais pas encore en France à cette heure.
La fracture des mémoires complique ici une histoire globale du renseignement pendant la Seconde guerre mondiale. C’est une mémoire partagée et une mémoire confrontée qui vont expliquer l’histoire de la fusion des différents services de renseignement dans le SDECE – NDLR : créé en 1946 – sous la IVe République et la Ve République. Donc la mémoire elle-même doit être reconstruite, quand elle peut l’être. Sur ces reconstructions, des mémoires professionnelles se sur-imposent : mémoire militaire, policière, douanière, ou gendarmique : autant d’approches et de tentatives de légitimation qui sont aussi des éléments dans la conquête des budgets ou des politiques publiques.