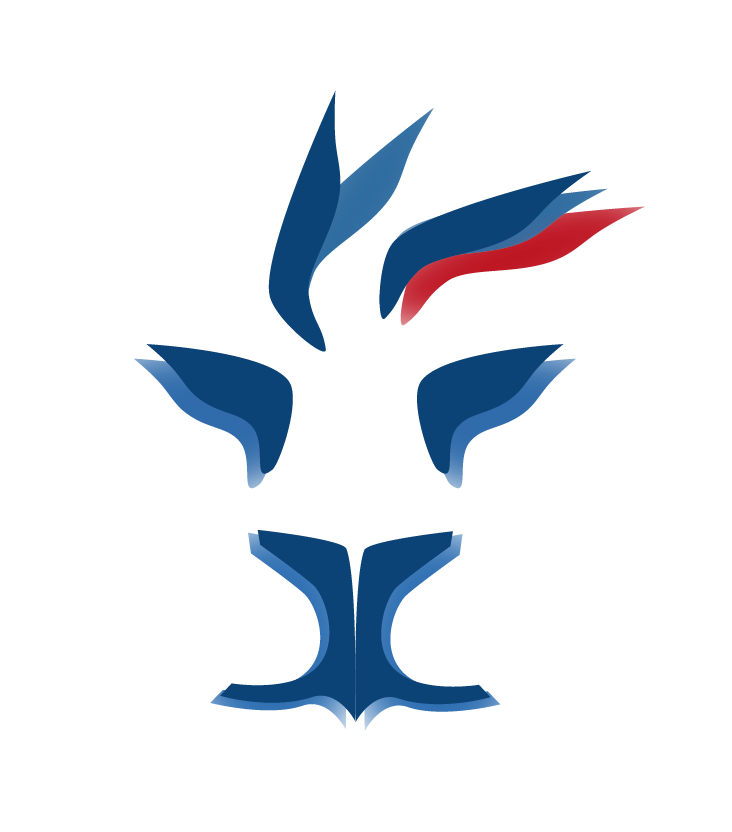Follow this link to read the interview in English.
Sir Malcolm Rifkind a été ministre de l’Europe entre 1983 et 1986, avant de rejoindre le gouvernement de Margaret Thatcher où il a été Ministre d’Etat pour l’Ecosse. Entre 1992 et 1997, il a été Secrétaire à la Défense et Secrétaire aux Affaires Etrangères. Il a finalement été Président de la commission Parlementaire du renseignement entre 22010 et 2015.
Sir Malcolm Rifkind livre dans cet entretien sa vision du Brexit, et nous fait profiter de sa considérable expérience des relations internationales.
Entretien réalisé par Camille de la Rochère et François Gaüzère-Mazauric le 23 novembre 2018 à Londres. Contributions de Sara Valeri, Solène Moitry et Benjamin Helman.
Vous avez été ministre d’Etat pour l’Europe au cours des années 80. Que pensez-vous des dernières avancées concernant les négociations relatives au Brexit ?
Nous avons toujours su qu’il s’agirait d’une négociation difficile, du fait de sa nature asymétrique. Habituellement, deux parties négocient : chacune a ses propres objectifs, est disposée à faire certains compromis et dispose d’une certaine marge de manœuvre. Dans le cas du Brexit, la situation était très différente et ce pour trois raisons : premièrement, le Royaume-Uni n’a pas simplement négocié avec la Commission Européenne mais aussi avec vingt-sept Etats. Deuxièmement, dès lors que l’article 50 avait été invoqué [NDLR : le 29 mars 2017], notre temps était compté : techniquement, nous quittons l’Union européenne en mars 2019. Si les négociations venaient à prendre du temps, nous serions les premiers à en pâtir. Troisièmement, nous sommes dans une position de demandeurs.
Il existe un autre problème : lors d’une négociation classique, chacune des parties accepte d’effectuer des compromis, mais ne révèle jusqu’où elle est prête à aller que dans l’étape finale de la discussion, une fois que les deux camps ont joué leurs dernières cartes et s’apprêtent à conclure l’accord. Si les négociations sur le Brexit ont peu ou prou suivi le même schéma, le véritable obstacle auquel s’est heurté le Royaume-Uni n’a pas été l’Union européenne mais bien son propre Parlement, sa propre opinion publique et ses propres médias. Quels compromis êtes-vous prêts à faire et quelles concessions pouvez-vous vous permettre ? Ce sont les véritables questions sous-jacentes, et ce depuis le début des tractations. Le gouvernement britannique a dû affronter cette pression, que ne subissait pas la commission européenne. Tous ces éléments constituent le cadre des négociations.
Nous avons désormais un accord – à la fois l’accord de retrait et la déclaration politique qui a entériné sa signature. Il n’est pas parfait, et les deux parties peuvent y trouver à redire, ce qui n’est pas surprenant. Selon moi, cet accord mérite d’être défendu et je souhaite qu’il soit voté. Je pense qu’une majorité des Britanniques dirait : « cette situation a déjà bien trop duré ».
Maintenant qu’un accord a été trouvé avec l’Union Européenne, le vote au Parlement pourrait donner lieu à trois scénarios : premièrement, un rejet pur et simple de l’accord, ce qui semble peu probable ; deuxièmement, le Parlement pourrait exiger des négociations supplémentaires sur certains points substantiels ; enfin, il pourrait soulever certains éléments mineurs, sans changer en profondeur les modalités de l’accord. Qu’en pensez-vous ?
Il n’existe pas réponse évidente qui nous permettrait de prédire avec certitude la tournure des évènements à venir. Lorsque le Gouvernement se présentera devant le Parlement au début du mois de décembre, il devra bénéficier du soutien de 325 Parlementaires sur 650. Il est peu probable qu’il atteigne cet objectif – tout du moins, au début – étant donné le nombre conséquent de conservateurs, partisans d’un hard Brexit à la Chambre des Communes – probablement pas plus de 30 ou 40, ce qui n’est néanmoins pas négligeable – ainsi que de dix Irlandais du Nord (qui soutiennent habituellement le Gouvernement). Si ces factions suivent le vote du Parti Travailliste et de l’opposition, alors le Gouvernement sera mis en échec.
Et pourtant, même si un tel scénario se produisait, ce ne serait pas la fin pour le Gouvernement. Le vote du 11 décembre pourrait bien être le premier d’une longue série. Il n’existe pas de loi l’interdisant. Contrairement à un référendum, dont le caractère exceptionnel requiert une année de préparation, le vote au Parlement pourrait être réitéré autant de fois que nécessaire.
L’opposition, et en particulier les conservateurs partisans d’un hard Brexit, rencontrent également des difficultés. Si j’étais l’un d’entre eux aujourd’hui, je leur dirais : « Soyons vigilants, nous pourrions gagner la bataille mais perdre la guerre ». L’enjeu de la guerre n’est pas l’accord mais le fait de savoir si le Royaume-Uni quittera l’Union Européenne en mars 2019. Si le Gouvernement remporte le vote et que l’accord est ratifié, rien n’empêchera plus notre départ au mois de mars – plus d’autorisation à obtenir, plus de vote, plus de procédures, cela se produira automatiquement. C’est ce que les partisans du Brexit veulent, c’est leur but ultime. En comparaison – et sans vouloir en minimiser l’importance – les modalités de l’accord relèvent du détail.
Pour remporter la bataille, les partisans du Brexit doivent s’associer avec des individus qu’ils apprécient encore moins que le Gouvernement. Ils doivent voter pour M. Corbyn et le Parti Travailliste, avec les libéraux-démocrates et les nationalistes écossais, qui ont des chacun leurs objectifs propres. Ces groupes estiment que le Gouvernement va trop loin. Ils veulent ou bien rester membres de l’Union Européenne, ou bien le Brexit le plus souple possible. Ainsi, la position officielle du Parti Travailliste consiste à dire : « nous devrions quitter l’Union européenne mais bénéficier d’une union douanière permanente ». Les Libéraux-démocrates et les Nationalistes écossais ne partagent pas ce point de vue : certains réclament un second référendum, d’autres souhaitent un accord sur le modèle de celui que la Norvège a négocié avec l’UE (ce qui reviendrait à rester dans le marché intérieur). Tous reconnaissent la nécessité d’un accord, contrairement à MM. Rees-Mogg et Johnson. Quel est l’intérêt de mettre le gouvernement en échec concernant quelque chose dont vous ne voulez pas pour, à terme, vous retrouver avec quelque chose qui vous convient encore moins ?
Winston Churchill – bien que ce ne soit pas à propos du Brexit – a dit un jour : « un homme politique ne devrait jamais se suicider – car il risquerait d’y survivre et de le regretter ».
Qu’est-ce cela signifie ? Je peux vous proposer quelques scénarios, et ce ne seront pas forcément ceux auxquels vous vous attendez. Tout d’abord, il faut bien garder à l’esprit la manière dont le Parlement votera. Lorsque cela arrivera, le vote ne se fera pas simplement pour ou contre l’accord proposé par le gouvernement. Le Parlement ne fonctionne pas de cette manière. Le Gouvernement déposera une motion invitant le Parlement à approuver cet accord. Le Parti Travailliste, en tant que principale force d’opposition, proposera sans doute un amendement en faveur d’une union douanière. Les Nationalistes et les Libéraux pourraient ensuite proposer un autre amendement en faveur d’un accord sur le modèle norvégien, d’un second référendum ou pour rester dans l’Union européenne. Chacun de ces amendements fera successivement l’objet d’un vote.
Comme vous devez le savoir, l’Angleterre n’a pas de constitution écrite ; le Président du Parlement se doit tout de même de respecter un ensemble de règles coutumières lorsqu’il prend sa décision. Ainsi, s’il y a d’un côté un texte émanant du Gouvernement et de l’autre des amendements, les amendements doivent être soumis au vote en premier ; la motion principale intervient seulement dans un second temps. En effet, si l’un des amendements était adopté, la motion principale devrait être révisée.
A moins que les choses ne se passent différemment cette fois-ci, le premier vote aura pour objet l’amendement relatif à une union douanière, proposé par le Parti Travailliste, puisqu’il s’agit de la première force d’opposition. Lors de ce vote, les partisans d’un hard Brexit, qui s’opposent à une union douanière permanente, voteront avec le Gouvernement. Les Irlandais feront de même, et l’amendement du Parti Travailliste sera rejeté.
Le second vote pourrait quant à lui concerner un accord sur le modèle norvégien, ou bien l’organisation d’un deuxième référendum. Puisque ces deux options ne font l’objet que de peu de soutien, ces amendements seront rejetés. In fine, ne restera qu’un seul vote : accepter la proposition du Gouvernement ou rejeter l’accord dans son intégralité. Il s’agit d’un choix cornélien, en particulier pour le Parti Travailliste. Les partisans du hard Brexit ne redoutent pas l’éventualité de ne pas parvenir à un accord – ils estiment pouvoir se satisfaire des règles imposées par l’Organisation Mondiale du Commerce. Le Parti Travailliste a un point de vue différent, de même que les Libéraux et les Nationalistes.
S’ils votaient contre l’accord, « ils se suicideraient et seraient condamnés à vivre dans le regret »…
Tout à fait. Si le vote final consistait à choisir entre un accord et un scénario de no deal, la motion de no deal remporterait tout au plus l’adhésion d’une centaine de Parlementaires – peut-être moins, selon moi. 500 Parlementaires, à savoir le Parti Travailliste, les Libéraux, les Nationalistes, les Irlandais et au moins la moitié des Conservateurs – voire deux tiers d’entre eux – se refuseraient à sortir sans aucun accord. Une telle éventualité est donc à proscrire ; le scénario d’un no deal doit être exclu. La seule véritable question est donc de savoir si l’accord sera ou non voté en décembre.
Une fois que les députés auront rejeté les amendements les uns après les autres, ils devraient s’accorder – sans enthousiasme – sur le fait que la proposition du Gouvernement demeure préférable à toute alternative.
Néanmoins, il reste possible que le Gouvernement échoue – bien que cela soit peu probable…
Si les Parlementaires ne sont pas prêts à accepter l’accord du Gouvernement et que celui-ci perd lors du vote, cette défaite ne sera pas irrémédiable. La Première ministre dira : « J’entends l’avis du Parlement. Je dédierai les deux prochaines semaines à renégocier certains points de l’accord. Je ne suis pas très optimiste, mais je ferai de mon mieux ». Et elle pourrait parvenir à changer un ou deux détails, des phrases, des éléments de langage. Il me paraît inconcevable que l’Union Européenne accepte d’ouvrir de nouvelles négociations. Pourquoi le ferait-elle ?
Theresa May se présentera à nouveau devant le Parlement, probablement au début du mois de janvier 2019 et dira : « Je suis désolée, vous avez le choix entre l’accord que j’ai négocié, et aucun accord ». Il serait alors possible que le Parti Travailliste, refusant l’éventualité de sortir de l’Union sans accord, en vienne à s’abstenir. Cependant, s’ils refusaient de s’abstenir, je suis persuadé que trente à quarante Parlementaires du Parti Travailliste alerteraient leur chef de file Jeremy Corbyn sur le risque de sortir sans accord, et envisageraient soit de s’abstenir, soit même de voter avec le Gouvernement. Je prends le temps de développer le sujet, car les enjeux sont importants.
Un ralentissement économique en conséquence du Brexit pourrait inciter le gouvernement Britannique à réduire les dépenses militaires et à se reposer sur les Etats-Unis, dans le cadre sécuritaire de l’Otan. Redoutez-vous un tel développement de cette « relation spéciale » ?
Non, certainement pas. Je pense que cela renvoie à la comparaison entre le Brexit et la volonté de Donald Trump de faire passer « les Etats-Unis en premier ». Cela n’a rien à voir. La seule comparaison qui puisse être effectuée entre le Brexit et l’élection de Donald Trump est que, dans les deux cas, les élites ont été défaites par le suffrage.
La presse internationale a pourtant approfondi cette comparaison, en utilisant comme facteur commun la défaite des élites…
C’est absurde. Tout d’abord, le Royaume-Uni ne peut être assimilé aux Etats-Unis ; nous sommes un pays européen. De Gaulle disait : « Le Royaume-Uni est un pays européen ; il est simplement un autre type de pays européen ». C’est une bonne remarque (rires).
Nous avons une relation très proche avec les Etats-Unis, et j’espère que cela perdurera, étant donné notre passé et notre culture communs. Toutefois, sur certains points, nos relations sont devenues plus difficiles sous le mandat du Président Trump que sous le mandat de tout autre Président américain – démocrate ou républicain.
Ce changement peut être transposé à plusieurs autres pays européens …
Tout à fait. D’aucuns pourraient s’étonner de constater à quel point, sur la plupart de ces questions, le Royaume-Uni est du côté des Européens et non du côté de Donald Trump. Nous croyons au libre-échange ; nous ne croyons pas aux droits de douane ; M. Corbyn lui-même croit au libre-échange. Ce point n’a rencontré aucune contestation dans la politique britannique depuis un siècle. Nous y croyons d’ailleurs bien plus que les Français, pardonnez-moi ! (Rires).
Nous croyons aussi à un ordre international régulé, comme la France, l’Allemagne, et l’Europe, mais au contraire de Donald Trump. Nous avons d’ailleurs expressément manifesté notre désaccord à propos de la plupart de ses initiatives controversées de politique étrangère. Nous travaillons de concert avec la France et l’Allemagne sur toute une série de problèmes, qu’il s’agisse de l’accord nucléaire iranien, de la question de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, ou encore du réchauffement climatique…
Trump a décidé de ses orientations, et nous avons manifesté notre désaccord. Pas simplement car nous souhaitons faire preuve de gentillesse envers la France et l’Allemagne, mais parce que notre jugement politique rejoint celui de l’Europe occidentale. Cela est très profond. Lorsque Theresa May dit – comme elle le fait souvent – « nous quittons l’Union Européenne, mais pas l’Europe », sa phrase a une signification géopolitique. Elle ne parle évidemment pas seulement de géographie, mais également de politique.
Pour revenir aux enjeux militaires que vous avez soulevés, la seule contrainte à laquelle le gouvernement britannique a été soumis ces dernières années a été d’augmenter les dépenses militaires. Il ne les réduira pas. Quand bien même il le voudrait, son propre parti l’en empêcherait, et moi le premier. A titre d’exemple, nos relations bilatérales en matière militaire avec la France n’ont jamais été aussi bonnes.
En tant qu’ancien secrétaire d’Etat pour l’Ecosse, à quel point pensez-vous que le Brexit puisse encourager l’indépendance écossaise ?
C’est ce que souhaiteraient les Nationalistes Ecossais. Mais cela n’arrivera pas – du moins pas dans un futur proche – pour plusieurs raisons. La raison principale est de nature technique : les Ecossais prônent l’indépendance dans le but d’intégrer ou de réintégrer l’Union Européenne. Ils souhaitent en effet bénéficier du marché interne, qui représente 20% des exportations écossaises, alors que 60% sont destinées au Royaume-Uni. Le marché unique le plus important pour l’Ecosse est celui du Royaume-Uni – comme pour l’Irlande. Ils sont membres du Royaume-Uni depuis plus de 300 ans, donc, en termes d’échanges économiques, cela n’a tout simplement aucun sens. Evidemment, l’Ecosse souhaiterait bénéficier du meilleur des deux mondes, et il est vrai que les Ecossais ont voté contre le Brexit – mais c’est aussi le cas de Londres.
Madame Sturgeon, Première ministre de l’Ecosse, a pensé attirer vers elle le suffrage, en arguant que les Ecossais avaient voté pour le remain, contrairement aux Anglais. Cela prouverait selon elle qu’il s’agit de pays différents, aux destinées différentes et que de ce fait, il devrait y avoir un nouveau référendum sur l’indépendance écossaise. Cette posture fut tellement impopulaire que lors des dernières élections générales, l’Ecosse s’est avérée être la seule région du Royaume-Uni où le Parti conservateur a progressé.
Au total, nous avons emporté treize sièges en Ecosse. Auparavant, nous n’en avions qu’un. D’où la question de savoir s’il devrait ou non y avoir un second référendum sur l’indépendance ou non. Les Ecossais ont dit : « Nous avons déjà eu un référendum : à 55% contre 45%, nous avons choisi de rester dans le Royaume-Uni. Les Nationalistes nous ont promis que ce référendum trancherait la question pour les cinquante prochaines années ; nous ne voulons pas d’autre référendum ». Je ne pense donc pas que cela se produira.
Pensez-vous que le parti nationaliste écossais s’obstinera à voter contre l’accord, malgré l’impopularité générée par cette position ?
Ils commenceront certainement par s’y opposer, mais rencontreront ensuite le même problème que le Parti Travailliste : la dernière chose qu’ils souhaitent est une absence totale d’accord. Ainsi, ce que nous évoquions précédemment s’applique également à eux. J’imagine que le fait de voter avec le Gouvernement les placerait dans une position délicate, et qu’ils pourraient in fine s’abstenir – qui sait ?
Ne craignez-vous pas que le Brexit ébranle la relation franco-britannique sur le long terme ?
Seulement si la France ou le Royaume-Uni le souhaitent, mais de toute évidence, ils ne le souhaitent pas. Le Président de la République Emmanuel Macron a été clair sur ce point : il souhaite fermement que notre entente soit renforcée, et nous partageons ce point de vue.
Il y a des divergences d’opinion, par exemple sur la création d’une armée européenne, mais ce n’est pas nouveau. Ce qui est intéressant, c’est qu’en tant qu’ancien ministre de la Défense, j’ai remarqué que ce n’est pas la première fois que certains appellent de leurs vœux la création de toutes sortes d’armées européennes, tout en sachant pertinemment que les Britanniques s’y opposeraient. Nous ne serons plus là pour nous y opposer. Vous voulez une armée européenne, alors vous en aurez-une et nous verrons ce qu’il se produira. Et je ne sais ce qu’il se produira…
Si une structure de défense européenne venait à se matérialiser, quelle serait à votre avis la position qu’adopterait à son égard le gouvernement britannique ?
Nous ne ferons plus partie de l’Union européenne. Si les Etats de l’Union Européenne souhaitent intégrer leurs forces armées, ce sera donc leur problème, et nous ne pourrons pas nous immiscer dans une telle décision. Néanmoins, nous considérons qu’ils doivent être particulièrement vigilants, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, souhaitent-il affaiblir l’Otan ? Certains acteurs en Europe n’y verraient pas d’inconvénient ; d’autres si. L’Allemagne, la Pologne, ou les Pays-Bas, ne souhaiteraient pas affaiblir l’Otan. Pour des raisons historiques, la France semble plus réservée sur le sujet.
Mais il y a une raison plus fondamentale, qu’il ne m’appartient pas de trancher : nous ne pouvons pas avoir une armée européenne sans avoir un Etat européen. L’idée même d’avoir une armée européenne commandée par vingt-sept états souverains est absurde. L’adoption d’une monnaie commune soulève des enjeux similaires : certes, il est possible de créer un tel outil ; toutefois, lorsque l’outil a été créé, une instance souveraine doit ensuite décider des modalités de son utilisation.
Je crains que nous ne nous retrouvions avec une structure qui n’aurait d’« armée européenne » que le nom.
Cela pourrait-il alors prendre la forme d’un accord financier ou d’un accord industriel ?
Cela serait ce que nous avons actuellement, mais probablement avec un nom plus grandiloquent.
Au contraire, l’Otan ne possède pas d’armée propre. Les pays membres de l’Alliance Atlantique s’engagent à y allouer une partie de leurs capacités militaires en cas de conflit. En ce sens, on pourrait considérer que l’Otan possède des capacités militaires. Il est également reconnu par tous que les Etats-Unis prendraient la tête des capacités militaires de l’Otan, étant donné qu’ils en fournissent une part considérable.
Au niveau européen, le Président Macron et d’autres ont semblé suggérer que l’Union européenne devait désormais avoir une armée européenne. Mais cela nécessiterait au moins l’existence d’un état fédéral. Je ne vois pas le sens de ce débat.
C’est d’ailleurs là une chose qui m’a rendu moins enthousiaste sur l’Union Européenne. Les dirigeants politiques en France, en Allemagne ou ailleurs ne sont pas prêts à reconnaître le caractère anormal de ce qu’ils sont en train de créer. Nous l’avons observé lors de la mise en place d’une monnaie unique ; ils disent deux choses différentes, en prétendant qu’elles sont équivalentes. Nous avons une monnaie commune, mais pourtant, cela ne signifie pas que nous progressions vers la création des Etats-Unis d’Europe, ce dont nous ne voulons toujours pas. Mais en réalité, petit à petit, on commence à évoquer une union bancaire, une union fiscale et tous les éléments nécessaires à son fonctionnement.
Par exemple, une monnaie commune ne peut fonctionner que si, lorsque vous avez des niveaux de vie différents, vous acceptez que les pays les plus riches subviennent au besoin des pays les plus pauvres par le biais de transferts fiscaux. C’était l’objet du « New Deal » de Roosevelt dans les années 1930 : l’ensemble des régions les plus pauvres des Etats-Unis, qui avaient un taux de chômage élevé, ont obtenu un soutien financier d’origine fédérale. C’est aussi ce qu’il se passe au Royaume-Uni : le Nord de l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Ecosse et le Pays de Galles, qui sont plus pauvres que le Sud-Est, bénéficient de davantage de crédits publics.
L’Union Européenne a certes une politique régionale, mais celle-ci demeure balbutiante : les sommes engagées sont trop faibles, et pourtant, vingt pays sont désormais enfermés dans une monnaie commune.
La monnaie commune n’est certes pas le sujet de notre entretien, mais le dilemme est similaire : ne parlez pas d’armée européenne si vous n’êtes pas prêts à reconnaître que cela revient à s’orienter vers la création d’un Etat européen.
Comme Emmanuel Macron, Angela Merkel a déclaré au Parlement Européen : « nous devons avoir une armée européenne ». Cela aurait été beaucoup plus cohérent qu’elle dise : « nous devons renforcer la coopération européenne en termes de standards et de capacités, afin que nos équipements soient interopérables ». Une armée doit être commandée ; elle ne peut avoir plusieurs personnes à sa tête. Une armée européenne nécessiterait la création d’une structure unique de commandement.
Cette armée européenne pourrait aussi être perçue comme une réponse aux attaques du Président Trump contre le multilatéralisme, notamment lors de son discours aux Nations Unies au mois de septembre…
Je ne suis pas d’accord, même si c’est un bon argument. Cela signifierait qu’à cause de Donald Trump, nous ne pourrions plus nous permettre d’être vingt-sept pays différents. Nous devrions de fait devenir, en un certain sens, une Europe fédérale. Mais les dirigeants politiques ne feront probablement pas preuve d’ambiguïté à ce sujet. Lorsque j’étais ministre des Affaires étrangères, Jacques Chirac était Président de la République, comme Mitterrand avant lui, mais ma remarque s’applique également à Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron : les gouvernements français successifs ont une attitude bien plus ambiguë à propos de la souveraineté que leurs homologues allemands, car les Français ont une conscience plus aigüe de leurs intérêts nationaux. Leur vision se rapproche de celle des Britanniques, à savoir celle d’un équilibre entre les intérêts nationaux et internationaux. Et pourtant – pardonnez-moi – ils multiplient les effets d’annonces et les slogans, tout en reconnaissant qu’il leur faudrait renoncer à une part de leur souveraineté pour mener les politiques qu’ils semblent appeler de leurs vœux.
Le Royaume-Uni a souvent été considéré comme le meilleur allié de l’Otan en Europe, et pourtant, il exprimé son souhait de prendre part aux initiatives de défense européenne. Que pensez-vous de la position actuelle du Royaume-Uni eu égard à la construction d’une Europe de la Défense ?
La défense européenne est évidemment bien plus le fait de l’Otan que de l’Union européenne ; il n’en revient pas moins aux Etats-membres de l’Union de décider du degré de collaboration et de coopération qu’ils souhaitent mettre en œuvre dans l’Union. Nous souhaitons incontestablement y contribuer, tant que cela n’affaiblit pas l’Otan. L’Alliance Atlantique demeure notre principale référence en termes de politique de défense. L’Otan, et les Américains eux-mêmes, ne s’opposeraient pas à une coopération européenne, ils l’appellent au contraire de leurs vœux. Plus l’Europe coopère, plus elle rentabilisera ses investissements en matière de défense. Si vous additionnez les budgets de défense de l’ensemble des pays européens, cela semble conséquent, mais si vous les traduisez en capacités militaires, ce n’est finalement pas si impressionnant.
C’est pourquoi il semble cohérent de rationaliser ces budgets. Vous pouvez le faire de deux manières : la plus spectaculaire consisterait à créer une armée européenne. Si cela n’est politiquement pas faisable ou pas souhaitable, il est toujours possible de standardiser les équipements au fil du temps. A chaque nouvel achat – qu’il s’agisse d’un nouveau char, d’un nouveau navire, ou d’un nouvel avion – chaque pays pourrait adopter le même modèle. Cela prendrait du temps mais progressivement, en 20 à 30 ans, les armées deviendraient parfaitement interopérables dans la perspective d’un conflit. Au cours de cette période, les entraînements communs pourraient être encouragés.
Il existe de multiples façons de ne pas pâtir de l’inexistence d’une armée européenne ; mais on ne peut l’appeler « armée européenne » que si c’en est une. Autrement, cela pourrait nous induire en erreur.
La France semble être déchirée entre sa relation bilatérale avec le Royaume-Uni en matière de défense basée sur les accords de Lancaster House d’un côté et, de l’autre, l’argument politique du Président de la République Emmanuel Macron en faveur d’un renforcement de l’Europe de la défense. N’est-ce pas difficile de concilier ces deux aspects ?
Sans doute cela ne devrait-il pas être si difficile. L’avenir de la politique étrangère britannique après le Brexit pose un problème similaire : aurons-nous ou non une UE+1 ? La négociation de l’accord sur le nucléaire iranien, lorsque l’Allemagne a rejoint les membres permanents du Conseil de sécurité pour les besoins de la négociation, a fourni un exemple probant du modèle que pourrait prendre notre association (NDLR : format P5+1). Nous pourrions faire de même en matière de politique étrangère et de défense. Cela semble plus facile pour la politique de défense : dans la mesure où nous sommes tous membres de l’OTAN, il existe déjà un forum de discussion commune. Pour peu qu’il y ait une volonté politique, ce ne sera pas difficile, car la France et le Royaume-Uni sont la clé de la défense européenne. Seuls ces deux pays disposent de capacités militaires substantielles ; ces capacités sont non seulement budgétaires, mais également opérationnelles. Les autres pays ont contribué de manière efficace, mais plus modeste, à la défense européenne.
Le débat sur la doctrine nucléaire se pose également. Si Donald Trump, ou tout autre futur président américain, ne manifestait pas une volonté affirmée d’engager les forces nucléaires américaines pour la protection de l’Europe (d’après l’article 5 du traité de l’Otan), alors personne ne souhaiterait la prolifération d’Etats détenteurs de l’arme nucléaire en Europe. Nul ne souhaite une arme nucléaire allemande, pas même les Allemands ; nul ne souhaite une arme nucléaire espagnole, italienne ou polonaise. Heureusement, l’Europe dispose de deux pays détenteurs de l’arme nucléaire, qui coopèrent aujourd’hui plus que jamais en matière de doctrine nucléaire.
Bien que cela soit hautement improbable, nous devons nous interroger sérieusement sur notre réaction, si Trump ou l’un de ses successeurs venait à dire : « Désolé, nous ne sommes désormais plus à même d’engager les Etats-Unis dans la défense de l’Europe ». Je pense qu’Angela Merkel a été imprudente en sous-entendant, dans son discours en mai 2017, que nous étions déjà parvenus à ce stade et qu’aujourd’hui, nous ne pouvions plus compter sur les Etats-Unis. Je pense que ce n’est pas vrai. J’ai demandé à un sénateur républicain chevronné s’il existait un sujet sur lequel les Républicains refuseraient de suivre Trump. Il m’a répondu « Oui, il y en a un : l’Otan. Si le président tentait sérieusement de nuire à l’OTAN ou de la détruire, je ne connais qu’un seul sénateur républicain qui pourrait le soutenir ». Je ne pense donc pas qu’il s’agisse d’un enjeu immédiat.
Toutefois, inciter à un renforcement de la coopération, comme le font la France et le Royaume-Uni, et réfléchir à chaque scénario, relève du bon sens.
Pensez-vous qu’en matière de défense, le Royaume-Uni privilégierait toujours l’Otan à une structure européenne commune ?
Si jamais nous devons un jour choisir entre l’Otan et une structure européenne, nous choisirons l’Otan. Si l’Europe, avec l’aval des Etats-Unis, prenait la tête d’une opération militaire, nous l’envisagerions en fonction des capacités militaires qu’elle nécessiterait. S’il s’agissait d’une opération de maintien de la paix ou d’une opération humanitaire, cela ne serait pas un problème ; l’Europe mène déjà ce type d’opérations, et elle les mène bien. En revanche, en cas d’affrontement majeur, nous serions insensés de ne pas nous appuyer sur les Américains. Même la France et le Royaume-Uni ne disposent pas de capacités assez développées pour faire face à des ennemis puissants.
Si nous y étions contraints, nous choisirions donc l’Otan, et non l’Europe.
Le rapport Jopling suggère d’adapter l’article 5 aux agissements relevant de la guerre hybride. Pensez-vous que c’est en ce sens que la doctrine de l’Otan devrait évoluer, si elle doit évoluer ?
Vous soulevez un point intéressant. Nous voulons transmettre à Moscou le message suivant : « Ne pensez pas que vous pouvez être aussi agressifs que vous le voulez tant que vous n’envoyez pas l’armée russe au-delà de vos frontières ». Nous l’avons constaté en Ukraine, où la Russie a nié toute implication … Des réponses peuvent toutefois être envisagées hors du champ de l’article 5. Cet article a pour vocation d’être la réponse la plus sérieuse, qui impliquerait normalement une attaque territoriale. Mais la Russie a été responsable d’une cyber-attaque de grande ampleur en Estonie [NDLR : en 2007]. Il faut réfléchir à une réponse appropriée pour de telles agressions, qui ne constituent pas une invasion territoriale.
Cela implique de très nombreuses étapes. Je pense qu’il faut réserver l’article 5 aux menaces les plus importantes. Cet article implique une déclaration de guerre, ce que personne ne souhaite. C’était le cas en 1914, lorsque les alliances ont eu une réaction disproportionnée suite à l’assassinat de l’archiduc (NDLR : François-Ferdinand d’Autriche), qui s’est soldé par la Première Guerre Mondiale. L’application de l’article 5 ne convient pas à la situation en Ukraine de l’Est. C’est quelque chose qu’il faut réserver aux pires cas de figure.
Et pensez-vous que l’organisation de l’Otan soit adaptée ?
Grâce à M. Poutine, elle est plus adaptée qu’elle n’aurait pu l’être. Vladimir Poutine a rendu service à l’Otan. Il a réveillé les gens après la proclamation de la « fin de l’Histoire » ; et l’Histoire a repris son cours. En ce sens, j’estime que l’organisation de l’Otan est adaptée.
Que pensez-vous de l’augmentation des cyber-attaques ?
Les cyber-attaques vont faire partie intégrante de notre paysage. Il est bien plus difficile de répondre à une cyber-attaque qu’à une attaque conventionnelle. Habituellement, en cas d’attaque conventionnelle, vous pouvez identifier avec certitude le responsable, alors qu’en cas d’attaque cyber, même si vous pensez connaître l’auteur, il est bien plus difficile de prouver son identité.
Au reste, une offensive cyber peut parfois servir l’intérêt général. Imaginez que Stuxnet (le logiciel malveillant utilisé par les Américains et les Israéliens pour enrayer le programme iranien d’enrichissement de l’uranium) ait fonctionné : la crise du nucléaire iranien se serait trouvée résolue sans un coup de feu, et sans qu’il y ait eu besoin de recourir à des sanctions. Imaginez maintenant qu’une cyber-attaque réussisse en Corée du Nord. Je ne prends pas beaucoup de risques à affirmer que des actions cyber américaines sont responsables de l’écrasement de certains missiles nord-coréens au décollage, lors des phases d’essai. Si les Américains détenaient pleinement cette capacité, cela représenterait un exemple de résolution de la crise nord-coréenne de manière très pacifique, par le biais d’une offensive cybernétique.
Nous réduisons souvent les offensives cyber aux tentatives russes de détruire des infrastructures nationales critiques, bien que cela en fasse partie. Mais nous devons adopter une approche plus large. Si les Russes et les Chinois sont ouverts à la discussion, j’espère au moins qu’ils commenceront à mettre en œuvre certains protocoles. Mais cela va être difficile. Nous n’y sommes pas encore.
En parlant de la Corée du Nord : quelle est votre vision de la stratégie de Donald Trump ?
Le Président Trump a rencontré Kim Jong-un une fois et a ensuite déclaré que la Corée du Nord ne représentait plus une menace nucléaire. Il n’y a pour le moment pas la moindre preuve de cela. On peut noter une avancée en particulier : l’amélioration des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il faut s’en réjouir mais nous ne savons pas avec certitude s’il s’agit d’une tactique de Kim Jong-un pour pouvoir affermir sa puissance tout en continuant de développer ses armes nucléaires, ou s’il s’agit de quelque chose de plus profond. Compte-tenu de l’homme et de son histoire, j’ai davantage de soupçons que d’espoirs.
Que pensez-vous de l’attitude des Etats-Unis envers l’Iran ?
A mon avis, les Américains sont tout à fait fondés à affirmer que les Iraniens subventionnent certaines organisations terroristes comme le Hezbollah. De telles critiques sont légitimes : la politique étrangère de l’Iran est particulièrement agressive ; ils ont tenté de détruire Israël. Selon moi, l’erreur commise par Donald Trump a été de refuser de considérer l’accord sur le nucléaire iranien comme un pas en avant.
Étonnamment, dans la mesure où les Européens ont refusé de suivre Trump sur ce sujet, la situation actuelle n’est pas si mauvaise : les Américains sont en mesure de mettre une grande pression sur l’Iran. Jusqu’ici, les Iraniens n’ont pas estimé nécessaire de poursuivre leur programme nucléaire, car ils se refusent à contrarier la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne. Ce n’est pas ce à quoi Trump s’attendait.
Il n’est pas certain que les pays européens soient en mesure de poursuivre leurs échanges commerciaux sans utiliser le dollar et en s’exposant eux-mêmes à des sanctions américaines…
C’est une question assez technique, mais pour le moment, les Iraniens respectent leur engagement de ne pas développer un programme nucléaire d’enrichissement de l’uranium et ils s’en tiennent aux clauses de l’accord, malgré le retrait américain. Le problème avec Donald Trump est que, lorsqu’il prend les bonnes décisions, il les prend pour les mauvaises raisons ; et lorsqu’il prend les mauvaises décisions, cela provoque parfois des conséquences positives…